Matériel Informatique
Surface Hub
Microsoft a dévoilé sa tablette tactile géante destinée principalement aux salles de réunion et aux entreprises. Fonctionnant sous le système d’exploitation Windows 10, la surface Hub dispose des outils professionnels indispensables, notamment la visioconférence. Le potentiel de cette technologie dans le milieu scolaire est indéniable. Hélas, il va falloir attendre que le coût baisse avant d’équiper les classes. Les deux formats proposés sont 55 pouces en full HD pour 10 200 € et 84 pouces en 4K pour 25 200 €. USB TYPE C Ce nouveau type de connecteur est réversible, néanmoins, le genre mâle ou femelle demeure. De la taille d’un micro USB, ce type d’USB est principalement installé depuis août 2016 sur les ordinateurs mais devrait s’étendre assez rapidement sur toutes les tablettes et peut-être les smartphones, Apple compris. L’USB-C pourrait à terme remplacer les types A et B pour devenir la norme universelle des appareils connectés.
Wifi basse consommation
Des chercheurs de l’Université de Washington ont créé un Wifi consommant très peu d’énergie. Cette technologie récupère un signal Wifi et le transmet via une borne relais de Wifi passif vers des terminaux. Avec un débit de 11 Mbit/s sur 30 mètres, ce nouveau mode de communication est adapté aux objets connectés en tout genre.
Cellule solaire miniature
Une équipe de chercheurs du MIT (Institut de technologie du Massachusetts) a développé un capteur photovoltaïque infiniment petit (50 fois plus fin qu’un cheveu) et très léger (le poids d’une bulle de savon) pour produire de l’énergie solaire. Selon les scientifiques, la découverte réside dans la méthode de fabrication. Cette cellule pourrait recouvrir les véhicules et les objets connectés dans un futur proche.
Moteurs de recherche et navigateurs
Qwant Junior
Lancée en déc. 2015, cette déclinaison pour enfants de 6 à 13 ans du moteur de recherche européen, assure que la navigation est sécurisée : sans site violent, sans site interdit au moins de 18 ans, sans e-commerce, sans publicité. En partenariat avec l’Éducation nationale, un onglet « Éducation » a été développé afin que les élèves obtiennent des résultats comprenant des contenus éducatifs.
Les professeurs des écoles peuvent se connecter sur le site avec un code fourni par l’Éducation nationale, puis signaler les contenus inappropriés. Un sérieux concurrent au SafeSearch de Google.
Le navigateur de rendu Servo
Le nouveau moteur de Mozilla permettra un affichage très rapide. Prévu en test pour juin, il intégrera Firefox ou un nouveau navigateur. À la différence de l’actuel moteur, Gecko (en C++), Rust, le langage de programmation utilisé pour Servo, a été élaboré par Mozilla. La communauté des développeurs repèrera les bugs et les fonctions manquantes pendant la période de test. Le but de la fondation est de propulser un navigateur ultraléger.
Le navigateur vivaldi
La version stable 1.0 est sortie après une année en bêta. Fruit de la scission de l’équipe du navigateur Opéra, en raison de divergences importantes sur l’évolution de ce dernier, ce navigateur se veut riche en paramétrages afin que les internautes puissent le régler à leur convenance. Ainsi, face à Explorer et Chrome, la liste des concurrents alternatifs s’allonge.
Applications et logiciels
Cortana et les chatbots
L’assistant personnel virtuel de Microsoft, Cortana, peut « discuter » avec l’utilisateur, effectuer des tâches et se connecter aux appareils mobiles. Donner la parole à toutes les applis grâce aux chatbots (agents conversationnels) est l’ambition de Microsoft. Ainsi, l’utilisateur, via Skype et Cortana, pourra dialoguer avec les applications et faire exécuter vocalement des tâches.
« Parle avec Google Docs »
Parler à son ordinateur est très tendance : désormais il est possible de dicter son texte à Google docs. Il suffit de se munir d’un microphone, puis, dans l’onglet « Outils », de sélectionner « Saisie vocale ». L’activation nécessite de cliquer sur l’icône en forme de micro qui s’affiche à gauche du document.
Brioler avec son smartphone
La société Ryobi, spécialisée dans le bricolage, propose l’application gratuite « Phone Works » pour réaliser des travaux. Parmi les outils que l’on peut connecter, se distinguent : le niveau laser, le mètre laser, le thermomètre infrarouge et la caméra d’inspection. Une application pas forcément utile dans un CDI sauf, peut-être, pour un réaménagement ! Dans tous les cas, les bricoleurs apprécieront ces nouveaux outils numériques.
Lecture numérique
Facebook vendeur de livres
Facebook favorise le développement de commerce intégré à son réseau social. Les « Éditions du Net » ont bien compris l’avantage de s’installer sur Facebook, lequel connaît dans le détail la vie de ses membres. Les achats se font sur une plateforme associée au réseau via l’espace publicitaire. Ainsi, l’internaute ne quitte jamais sa page et achète les ouvrages qui lui sont proposés grâce aux informations recueillies sur son compte Facebook (data mining).
Lecture et dyslexie
Le développeur suédois, Victor Widell, a créé un petit programme sous forme de Plugin qui permet de se rendre compte des difficultés d’une personne dyslexique lorsqu’elle lit un texte. L’un des symptômes de la dyslexie est l’impression que les lettres changent de place en permanence. Le module, qui peut s’intégrer dans un navigateur, bouge les caractères de chaque mot de façon aléatoire et rend la lecture vraiment pénible, au point d’avoir la migraine au bout de 5 minutes… Actuellement, il existe des programmes, telle l’application Dys, qui facilitent la lecture numérique des dyslexiques en espaçant les lettres.
Librairie numérique Glose
La plateforme a profité du Salon du livre de Paris pour annoncer son intention de s’implanter dans le paysage français. Forte de plus de 800 000 titres, Glose apparaît comme un poids lourd dans le domaine de la librairie numérique. Ses principaux atouts sont : des livres enrichis (prise de notes, archivage, partage) et un club littéraire (échanges entre internautes). Glose envisage d’offrir plus de contenu pédagogique pour le système éducatif.
Livre numérique sans dépot légal
La loi Création, censée « protéger les artistes, la liberté, la diversité » selon la ministre de la Culture, n’a finalement pas pris en compte les livres numériques. Actuellement, les éditeurs n’ont aucune obligation de déposer les ouvrages numériques à la Bibliothèque nationale de France. Seuls les distributeurs et les robots collecteurs de la BnF font cette démarche. Par conséquent, les oeuvres nativement numériques ne sont pas forcément recensées et donc protégées, alors qu’il suffirait d’envoyer un Epub ou un PDF.
Éducation
Canopé et Amazon se rapprochent
Le but du réseau Canopé est de publier des ressources pédagogiques via le service Kindle Direct Publishing d’Amazon afin de diffuser plus largement ses ouvrages. Parallèlement, des ateliers sur l’autopublication vont être proposés par Canopé jusqu’à l’automne 2016 afin d’inciter les enseignants à publier des contenus éducatifs pour tous. Pas sûr que les éditeurs et les librairies apprécient beaucoup ce rapprochement juste au moment de la réforme des programmes et l’édition de nouveaux manuels scolaires.
Platerorme Lirelactu
Le Ministère de l’Éducation nationale a dévoilé pendant la semaine de la presse le projet de plateforme de presse Lirelactu.fr, en accès gratuit pour les établissements scolaires. Opérationnelle dès septembre 2016, elle proposera dans un premier temps une quinzaine de titres. Cet outil favorisera le décryptage de l’information dans le cadre de séances pédagogiques. Ce projet a été réalisé en partenariat avec MiLibris et la presse généraliste.
Belearner
Cet outil de scénarisation de parcours pédagogiques réunit du texte, de l’image, du son et de la vidéo. De nombreuses interactions peuvent être programmées dans le scénario, par exemple : quizz, questions, liens, commentaires, textes à trous.
La progression de l’élève est interactive et personnalisée. Cette plateforme transmédias innovante en matière d’e-éducation est dorénavant intégrable aux ENT des établissements scolaires.
Renkan
Permet la création, le partage, l’édition en temps réel par plusieurs personnes de cartes heuristiques. Collaboratif, très complet et aisé d’utilisation, ce programme est développé par l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) du Centre Pompidou. Renkan sera inclus dans les ENT dans le cadre du projet MétaEducation (E-éducation 2) pour les lycées.
Droit et données personnelles
Le virus Locky
Ce rançogiciel, d’une très grande virulence, se répand en France depuis mars 2016. Il arrive par mail et emprunte des adresses familières de l’internaute (nom de l’entreprise, du fournisseur internet, de l’établissement scolaire,..). Le piège se trouve dans la pièce jointe, qui, si elle est ouverte, crypte tous les documents et réclame une rançon en bitcoin (monnaie virtuelle internationale) pour déverrouiller les données. D’autres redoutables ransomwares, tels Petya et KeRanger, peuplent également le Net.
Que sait Google de nous ?
Google collecte de très nombreuses données sur nous grâce à un important dispositif incluant des appareils, des logiciels et des services. Plus Google en sait sur nous, plus il gagne d’argent, via la publicité ciblée.
Le site « The lone wolf librarian » explique clairement, sous la forme d’un schéma, comment Google sait presque tout de nous : qui nous sommes, où nous habitons, ce que nous pensons, ce que nous faisons en ligne, où nous nous déplaçons, à qui nous parlons, comment nous dépensons notre argent…
Les bibliothèques américaines et les libertés numériques
Après avoir installé un relais du réseau TOR (réseau de navigation anonyme), les bibliothécaires d’une ville des États-Unis ont été interrogés par la police locale, à la demande de l’Agence fédérale de la sécurité intérieure. Malgré les pressions, ils ont décidé, avec l’accord de la municipalité, de rebrancher le relais 5 semaines plus tard afin de respecter la vie privée des usagers.
Mise en demeur de Facebook par la CNIL
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis en demeure Facebook, le 8 février 2016, à propos de ses manquements à la loi française quant à la collecte et à l’exploitation des données des internautes français. La CNIL, en charge de la protection des données personnelles, pointe du doigt : la publicité ciblée sans consentement, les données très sensibles (ex : dossier médical), le cookie « Datr » intrusif pour les non-membres, le manque d’information sur le transfert des données aux USA et l’utilisation du Safe Harbor.
Chiffrement : Apple contre FBI
Le géant de Cupertino refuse d’ouvrir une brèche dans le chiffrement des données des iphones pour aider la police fédérale à accéder au contenu du téléphone du terroriste de San Bernardino. Les autorités américaines démentent vouloir obtenir librement des données par un accès caché et sécurisé, de façon légale. Apple affirme que cela affaiblirait la sûreté des téléphones et mettrait en danger les utilisateurs des pays au régime dictatorial. Toute la Silicon Valley soutient la firme à la pomme.
Finalement, le FBI est passé outre et, grâce à un tiers, a réussi à décrypter les données du téléphone. Edward Snowden l’avait annoncé dès le début de l’affaire.
No Future…
Paiement par selfie
Amazon envisage que l’internaute puisse payer par selfie vidéo grâce aux outils de reconnaissance faciale. La société a déposé un brevet auprès de l’organisme américain US Patent & Trademark Office, bien que la technique ne soit pas encore au point.
Amazon vise à remplacer le classique mot de passe par le selfie, lequel serait plus sûr et ludique. Paypal et Mastercard, entre autres, étudient une technologie similaire.
Art et IA
À la Gray Area Foundation for the Arts de San Francisco s’est tenue une exposition d’oeuvres réalisées par un programme d’intelligence artificielle, créé par Google, spécialisé dans la reconnaissance visuelle. Cet algorithme, baptisé Deep Dream, peut produire des images à partir de ce qu’on lui soumet visuellement.
Ces créations hallucinantes et oniriques de l’IA ont été vendues jusqu’à 8 000 $, pour certaines.
Exosquelettes pour qui ?
Pour le moment destinés au marché japonais, Panasonic fait la promotion de ses exosquelettes avec des vidéos mettant en scène différents types de robots-assistants. Deux modèles s’adressent aux manutentionnaires amenés à soulever des charges très lourdes. À n’en pas douter, les ouvriers vont être ravis de se transformer en homme bionique…
Le Chatbot Tay
L’IA conversationnelle de Microsoft pour Twitter aura connu une très courte existence en raison de ses dérapages. Conçue pour séduire les adolescents et les jeunes adultes, elle utilisait des données publiques pour communiquer avec les internautes. Très rapidement, une attaque de trolls du Net l’a fait déraper en lui faisant tenir des propos racistes et misogynes. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, prévoit de rendre son IA moins influençable.
Drone autonome
Avec Phantom 4 de DJI, plus besoin d’être un as du pilotage. Celui-ci est capable d’éviter automatiquement un obstacle grâce à des capteurs et un programme d’intelligence artificielle. Paramétrer un parcours déterminé est une des options disponibles.
Y a-t-il un pilote dans le drone !
Holoportation
Le casque de réalité augmentée Hololens de Microsoft autorise la vision et la discussion avec des représentations holographiques de nos contacts. Pour l’instant, cette technologie, au coût très élevé, exige l’utilisation de caméras pour reproduire en trois dimensions le sujet. Nul doute que ce mode de communication révolutionnaire deviendra plus attractif que le chat vidéo. Dans quelques années, communiquer avec ses proches ou ses élèves sous forme d’hologrammes sera commun !


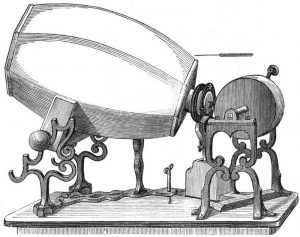
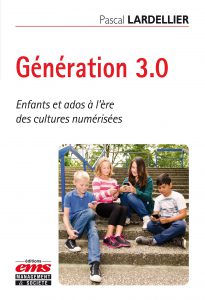 La troisième partie scrute les relations devenues très (trop) souples entre notre jeunesse et la culture. Les enquêtes PISA convergent avec les analyses les plus pessimistes. Faut-il avoir la foi dans une vision rousseauiste et cybernétique qui exclut l’enseignant de la transmission réservant cette dernière à une initiation entre pairs via la technologie ? Pascal Lardellier répond à cette problématique par la négative en dépit des « serious games » et autres MOOC. Car si Internet démocratise l’accès à la culture, cette dernière reste réservée à ceux qui peuvent décrypter Internet. Cette démocratisation technologique est un trompe-l’oeil, car elle incite à la paresse intellectuelle et empêche l’esprit de créer des rapprochements, de chercher des solutions autres que celles présentées toutes faites sur le Net. Dès lors, les enseignements, les enseignants et l’École perdent leur légitimité, leur autorité au profit d’une remise en cause permanente qui, bien souvent, ridiculise l’enseignant au profit d’un solutionnisme technologique15 souvent limité aux toutes premières occurrences offertes par Google lors de recherches effectuées à la demande des enseignants.
La troisième partie scrute les relations devenues très (trop) souples entre notre jeunesse et la culture. Les enquêtes PISA convergent avec les analyses les plus pessimistes. Faut-il avoir la foi dans une vision rousseauiste et cybernétique qui exclut l’enseignant de la transmission réservant cette dernière à une initiation entre pairs via la technologie ? Pascal Lardellier répond à cette problématique par la négative en dépit des « serious games » et autres MOOC. Car si Internet démocratise l’accès à la culture, cette dernière reste réservée à ceux qui peuvent décrypter Internet. Cette démocratisation technologique est un trompe-l’oeil, car elle incite à la paresse intellectuelle et empêche l’esprit de créer des rapprochements, de chercher des solutions autres que celles présentées toutes faites sur le Net. Dès lors, les enseignements, les enseignants et l’École perdent leur légitimité, leur autorité au profit d’une remise en cause permanente qui, bien souvent, ridiculise l’enseignant au profit d’un solutionnisme technologique15 souvent limité aux toutes premières occurrences offertes par Google lors de recherches effectuées à la demande des enseignants.
 La Société des amis de Colette a été un des fers de lance de la mobilisation pour la sauvegarde de la maison natale, mais c’est une autre association, créée spécifiquement pour la gestion du lieu, l’association « La Maison de Colette », qui en est actuellement propriétaire. La Société des amis de Colette aura bien sûr son siège dans la maison et continuera à être une association littéraire et scientifique. Concernant l’acquisition de la maison, rien ne fut facile et ce, malgré l’importance patrimoniale du lieu qui, très vite, et à notre demande, a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire des monuments historiques et a été reconnue par le label « Maison des illustres ». La crise, disait-on déjà, le manque d’intérêt des grands mécènes pour le patrimoine littéraire, le désengagement des collectivités qui craignent de nouvelles charges dans des budgets de plus en plus contraints… Beaucoup de raisons ont été avancées lorsque la mobilisation a débuté en 2009- 2010. Le tournant a été la soirée à bénéfices organisée au théâtre du Châtelet avec une distribution prestigieuse : Carole Bouquet, Guillaume Gallienne, Mathieu Amalric, Juliette, Leslie Caron, André Ferréol, Didier Sandre, Sabine Haudepin… « Colette en scène » a permis de faire connaître la mobilisation à un large public grâce à une importante couverture médiatique et ainsi de récolter des fonds. Le succès a également attiré l’attention du ministre de la Culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, qui a immédiatement apporté son soutien au projet et a entraîné dans son sillage la Région et le Département. C’est ainsi que nous avons pu, au mois de septembre 2011, acquérir la maison. Mais le plus dur restait à venir…
La Société des amis de Colette a été un des fers de lance de la mobilisation pour la sauvegarde de la maison natale, mais c’est une autre association, créée spécifiquement pour la gestion du lieu, l’association « La Maison de Colette », qui en est actuellement propriétaire. La Société des amis de Colette aura bien sûr son siège dans la maison et continuera à être une association littéraire et scientifique. Concernant l’acquisition de la maison, rien ne fut facile et ce, malgré l’importance patrimoniale du lieu qui, très vite, et à notre demande, a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire des monuments historiques et a été reconnue par le label « Maison des illustres ». La crise, disait-on déjà, le manque d’intérêt des grands mécènes pour le patrimoine littéraire, le désengagement des collectivités qui craignent de nouvelles charges dans des budgets de plus en plus contraints… Beaucoup de raisons ont été avancées lorsque la mobilisation a débuté en 2009- 2010. Le tournant a été la soirée à bénéfices organisée au théâtre du Châtelet avec une distribution prestigieuse : Carole Bouquet, Guillaume Gallienne, Mathieu Amalric, Juliette, Leslie Caron, André Ferréol, Didier Sandre, Sabine Haudepin… « Colette en scène » a permis de faire connaître la mobilisation à un large public grâce à une importante couverture médiatique et ainsi de récolter des fonds. Le succès a également attiré l’attention du ministre de la Culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, qui a immédiatement apporté son soutien au projet et a entraîné dans son sillage la Région et le Département. C’est ainsi que nous avons pu, au mois de septembre 2011, acquérir la maison. Mais le plus dur restait à venir… Une place centrale. Je ne connais pas d’autre exemple en littérature d’un écrivain qui a consacré autant de pages à sa maison natale. Colette est née et a grandi dans cette maison, elle y a passé les dix-huit premières années de sa vie. Une période essentielle de sa formation. À l’automne 1891, la famille a dû brutalement quitter le village du fait de dettes et d’une mauvaise réputation. Ce départ a été pour la jeune femme un véritable traumatisme. Plus tard, devenue écrivaine, elle choisit de recréer sa maison et son village par l’écriture. La maison devient alors un thème récurrent de l’œuvre, à tel point qu’un de ses lecteurs, sensible à l’importance qu’elle avait pour Colette, a décidé en 1925 de la racheter et de la redonner à Colette. « Je crois au merveilleux » lui avait-elle écrit. Parmi les œuvres majeures consacrées à la maison, il faut bien sûr citer La Maison de Claudine (1922), La Naissance du jour (1928) et Sido (1930) qui constitue une sorte de triptyque dédié au village natal et au personnage de Sido, sa mère.
Une place centrale. Je ne connais pas d’autre exemple en littérature d’un écrivain qui a consacré autant de pages à sa maison natale. Colette est née et a grandi dans cette maison, elle y a passé les dix-huit premières années de sa vie. Une période essentielle de sa formation. À l’automne 1891, la famille a dû brutalement quitter le village du fait de dettes et d’une mauvaise réputation. Ce départ a été pour la jeune femme un véritable traumatisme. Plus tard, devenue écrivaine, elle choisit de recréer sa maison et son village par l’écriture. La maison devient alors un thème récurrent de l’œuvre, à tel point qu’un de ses lecteurs, sensible à l’importance qu’elle avait pour Colette, a décidé en 1925 de la racheter et de la redonner à Colette. « Je crois au merveilleux » lui avait-elle écrit. Parmi les œuvres majeures consacrées à la maison, il faut bien sûr citer La Maison de Claudine (1922), La Naissance du jour (1928) et Sido (1930) qui constitue une sorte de triptyque dédié au village natal et au personnage de Sido, sa mère. Le travail de reconstitution, ou plutôt de recréation, des jardins, a été mené de façon exemplaire par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste ; il s’est agi de retrouver l’état originel des jardins dont le souvenir était conservé par quelques rares photographies, des gravures, quelques minutes d’un film des années 50 et, bien sûr, par les textes de Colette. Nous avons d’abord procédé à une relecture de toute l’oeuvre (une soixantaine de volumes…) à la recherche des descriptions des trois jardins : jardin d’en face, jardin-du-haut et jardin-du-bas. Cette lecture nous a permis de retrouver toutes les plantes, arbres et arbustes présents et leurs emplacements respectifs. Ensuite, il a fallu se replonger dans l’histoire de la botanique et retrouver, ce fut le travail de Mme Phiquepal, les modes et les techniques de plantation à cette époque, dans le contexte d’un jardin de ville. Ce fut notamment possible grâce au manuel qu’utilisait Sido au jardin et dont nous avons pu retrouver un exemplaire. Les quelques espèces qui étaient d’origine – notamment les célèbres glycines de la terrasse et de la rue des Vignes – ont pu être conservées, pour le reste nous avons repris l’ensemble des espaces, remodelé les allées et planté toutes les espèces avec le souci d’acquérir auprès de pépiniéristes spécialisés, notamment dans le cas des rosiers et des arbres fruitiers, les espèces anciennes décrites par Colette. Il en ressort un jardin tout à fait extraordinaire, à la fois jardin végétal et jardin de papier, puisque pour chaque plante nous avons un texte de Colette, description ou anecdote, correspondant.
Le travail de reconstitution, ou plutôt de recréation, des jardins, a été mené de façon exemplaire par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste ; il s’est agi de retrouver l’état originel des jardins dont le souvenir était conservé par quelques rares photographies, des gravures, quelques minutes d’un film des années 50 et, bien sûr, par les textes de Colette. Nous avons d’abord procédé à une relecture de toute l’oeuvre (une soixantaine de volumes…) à la recherche des descriptions des trois jardins : jardin d’en face, jardin-du-haut et jardin-du-bas. Cette lecture nous a permis de retrouver toutes les plantes, arbres et arbustes présents et leurs emplacements respectifs. Ensuite, il a fallu se replonger dans l’histoire de la botanique et retrouver, ce fut le travail de Mme Phiquepal, les modes et les techniques de plantation à cette époque, dans le contexte d’un jardin de ville. Ce fut notamment possible grâce au manuel qu’utilisait Sido au jardin et dont nous avons pu retrouver un exemplaire. Les quelques espèces qui étaient d’origine – notamment les célèbres glycines de la terrasse et de la rue des Vignes – ont pu être conservées, pour le reste nous avons repris l’ensemble des espaces, remodelé les allées et planté toutes les espèces avec le souci d’acquérir auprès de pépiniéristes spécialisés, notamment dans le cas des rosiers et des arbres fruitiers, les espèces anciennes décrites par Colette. Il en ressort un jardin tout à fait extraordinaire, à la fois jardin végétal et jardin de papier, puisque pour chaque plante nous avons un texte de Colette, description ou anecdote, correspondant. Les œuvres de Colette sont pour la plupart disponibles en collection de Poche et ont, pour certaines, fait l’objet d’éditions scolaires. Je conseillerais en complément des textes connus l’achat de Colette journaliste (Seuil/Libretto) qui peut fournir aux élèves et aux enseignants une approche originale de l’oeuvre, et une anthologie que j’avais réalisée pour Gallimard intitulée Mère et Fille (coll. Folioplus classiques). La biographie de référence est celle de Claude Pichois et d’Alain Brunet (éd. de Fallois/Livre de Poche), mais elle est d’un abord difficile par des élèves. Celle de Gérard Bonal (éd. Perrin) est plus accessible, mais son format est assez peu adapté. Il faudra donc rediriger les élèves vers les biographies de Jean Chalon (Colette. L’éternelle apprentie) et de Geneviève Dormann (Amoureuse Colette), toutes deux disponibles en collection de Poche. La revue TDC avait sorti en 2004 un numéro spécial Colette. Le Monde a publié en septembre 2015 un hors-série « Colette l’affranchie ». Le documentaire sur Colette qui avait débuté la série Un siècle d’écrivains n’est malheureusement toujours pas disponible en DVD, mais on peut visionner le Colette (1951) de Yannick Bellon (éd. Doriane films, 2014), un des rares documents filmés sur l’écrivain, et aussi J’appartiens à un pays que j’ai quitté de Jacques Tréfouël et Gérard Bonal (éd. Films du lieu-dit, 2004) qui serait une bonne introduction à une visite à Saint-Sauveur.
Les œuvres de Colette sont pour la plupart disponibles en collection de Poche et ont, pour certaines, fait l’objet d’éditions scolaires. Je conseillerais en complément des textes connus l’achat de Colette journaliste (Seuil/Libretto) qui peut fournir aux élèves et aux enseignants une approche originale de l’oeuvre, et une anthologie que j’avais réalisée pour Gallimard intitulée Mère et Fille (coll. Folioplus classiques). La biographie de référence est celle de Claude Pichois et d’Alain Brunet (éd. de Fallois/Livre de Poche), mais elle est d’un abord difficile par des élèves. Celle de Gérard Bonal (éd. Perrin) est plus accessible, mais son format est assez peu adapté. Il faudra donc rediriger les élèves vers les biographies de Jean Chalon (Colette. L’éternelle apprentie) et de Geneviève Dormann (Amoureuse Colette), toutes deux disponibles en collection de Poche. La revue TDC avait sorti en 2004 un numéro spécial Colette. Le Monde a publié en septembre 2015 un hors-série « Colette l’affranchie ». Le documentaire sur Colette qui avait débuté la série Un siècle d’écrivains n’est malheureusement toujours pas disponible en DVD, mais on peut visionner le Colette (1951) de Yannick Bellon (éd. Doriane films, 2014), un des rares documents filmés sur l’écrivain, et aussi J’appartiens à un pays que j’ai quitté de Jacques Tréfouël et Gérard Bonal (éd. Films du lieu-dit, 2004) qui serait une bonne introduction à une visite à Saint-Sauveur.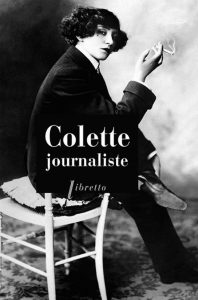 Je me méfie beaucoup du mot et de cette obsession de la modernité comme justification à l’étude d’un auteur ou d’une œuvre… Toutefois, je dirais que la vie et l’œuvre de Colette ont annoncé, et parfois devancé, de nombreuses préoccupations contemporaines en ce qui concerne la liberté, l’émancipation et l’indépendance des femmes, les questions de genre et les représentations du masculin et du féminin, la place des animaux et l’unité du vivant (« Il n’y a qu’une bête » affirmait-elle) et l’autofiction, dont elle fut, sans que le mot fût inventé, une des pionnières. Au-delà des sujets et même des intrigues de ses romans et de ses nouvelles, il y a la langue, le choix du mot, le travail difficile de l’écrivain, le regard sans jugement qu’elle porte sur les êtres et tout un univers de sensations que l’écriture ouvre intact au lecteur. Il y a d’abord un plaisir véritable à lire Colette. Sa vie, par l’exemple d’audace et de liberté qu’elle offre, comme son œuvre, par la variété et la richesse des thèmes qu’elle aborde, demeurent une source d’inspiration formidable.
Je me méfie beaucoup du mot et de cette obsession de la modernité comme justification à l’étude d’un auteur ou d’une œuvre… Toutefois, je dirais que la vie et l’œuvre de Colette ont annoncé, et parfois devancé, de nombreuses préoccupations contemporaines en ce qui concerne la liberté, l’émancipation et l’indépendance des femmes, les questions de genre et les représentations du masculin et du féminin, la place des animaux et l’unité du vivant (« Il n’y a qu’une bête » affirmait-elle) et l’autofiction, dont elle fut, sans que le mot fût inventé, une des pionnières. Au-delà des sujets et même des intrigues de ses romans et de ses nouvelles, il y a la langue, le choix du mot, le travail difficile de l’écrivain, le regard sans jugement qu’elle porte sur les êtres et tout un univers de sensations que l’écriture ouvre intact au lecteur. Il y a d’abord un plaisir véritable à lire Colette. Sa vie, par l’exemple d’audace et de liberté qu’elle offre, comme son œuvre, par la variété et la richesse des thèmes qu’elle aborde, demeurent une source d’inspiration formidable.