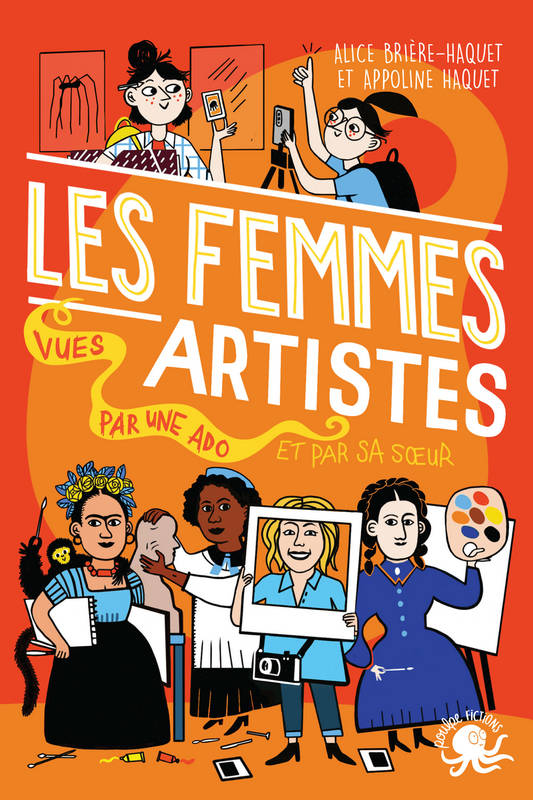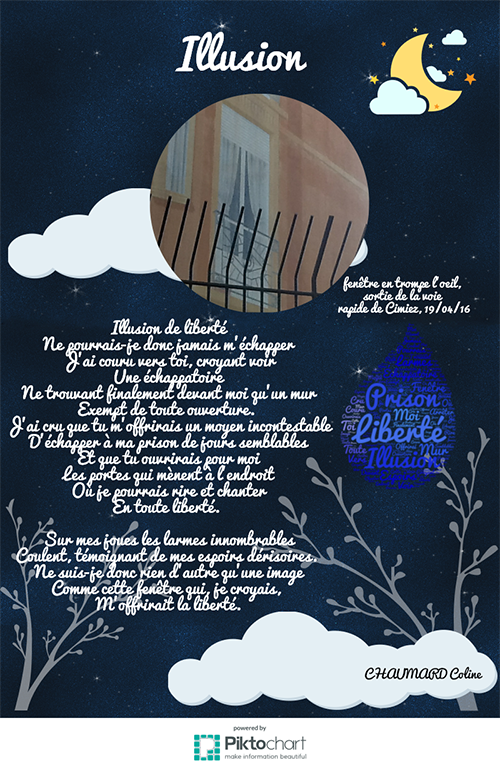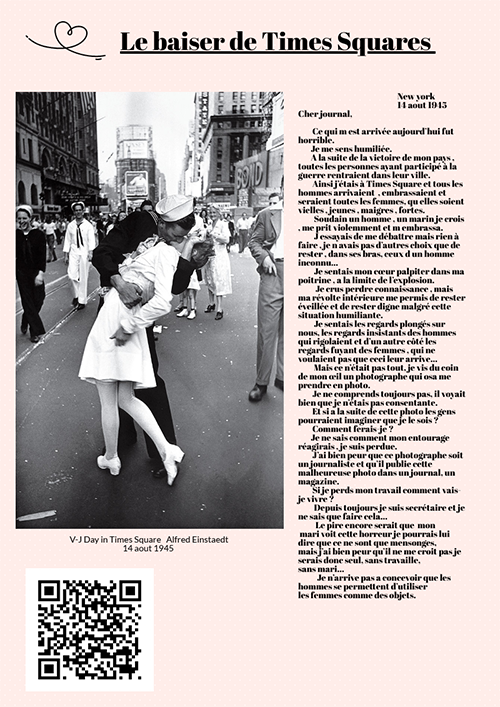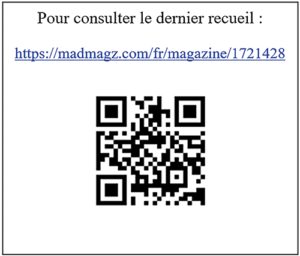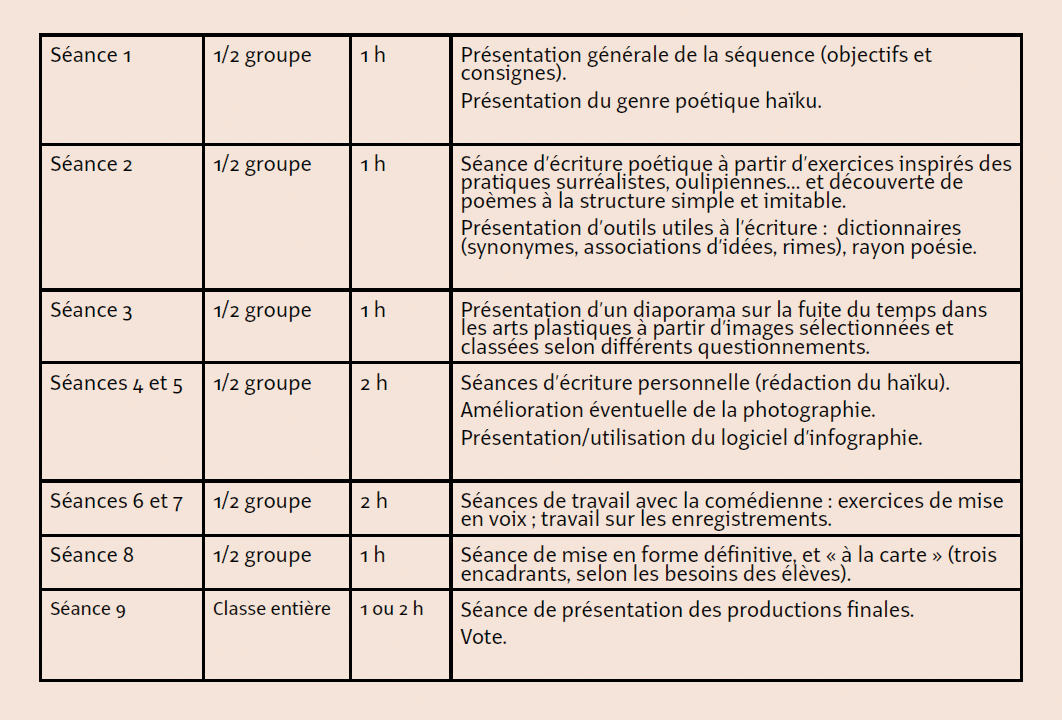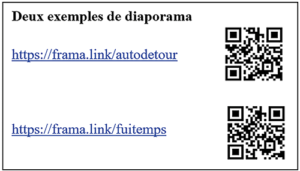Face à l’essor des outils numériques, les professeurs-documentalistes repensent leur rôle de médiateurs de l’information, accompagnateurs du numérique et garants d’une utilisation éthique des nouvelles technologies. Dans un contexte de transformation numérique, les CDI se réinventent, cherchent à répondre aux attentes plurielles et évolutives des usagers (Maury, et al., 2018). L’évolution rapide de l’IA impose aux praticiens de constamment s’adapter, d’actualiser leurs compétences et de prendre en considération l’émergence de nouveaux outils et enjeux éthiques et pédagogiques (Savar, 2024). Les professeurs-documentalistes occupent une place clé dans l’accompagnement des jeunes face à l’IA, dont la compréhension constitue un levier pour appréhender les mécanismes de notre société contemporaine (Garnier, et al., 2025). Cet article explore les potentialités de l’IA en contexte éducatif et en questionne les usages.
Médiateurs numériques, médiateurs documentaires, les professeurs-documentalistes cherchent à développer les compétences des élèves dans l’accès autonome et réfléchi à l’information et aux connaissances. Ils développent une politique de lecture quel que soit le support et forment les élèves à l’utilisation des outils numériques de manière critique et responsable. Cependant, l’utilisation pédagogique de ces outils soulève de nombreuses questions, notamment éthiques, concernant la confidentialité des données ou encore la protection de la vie privée. Comment le professeur-documentaliste peut-il utiliser l’IA pour engager les élèves dans des pratiques de lecture de manière efficace et éthique, tout en favorisant leur littératie numérique et leur autonomie ?
Le présent travail rend compte d’une recherche-formation menée avec des étudiants préparant le Capes de documentation, amenés à se projeter dans la profession en élaborant des scénarios pédagogiques mêlant lecture et numérique. Enseignante à l’université de Montpellier, nous avons demandé à 14 étudiants inscrits en master 1 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) parcours documentation de se projeter dans un contexte de Centre de documentation et d’information (CDI) de collège ou de lycée et de concevoir des séances visant à susciter l’envie de lire et à expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques intégrant des outils numériques, notamment l’intelligence artificielle.
Il semble crucial de prendre en compte le nouvel écosystème numérique dans lequel nous évoluons et de penser les pratiques d’enseignement et d’apprentissage du lire-écrire en intégrant les IAG (Acerra, Gervais & Petitjean, 2024). En nous appuyant sur la circulaire de missions de 2017, qui précise que le professeur-documentaliste met en œuvre des animations et des activités pédagogiques autour du livre et développe une politique de la lecture en collaboration avec les autres enseignants (Circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017), nous avons donné aux étudiants la consigne suivante :
Construire un scénario pédagogique intégrant l’IA au service de la lecture à l’école
Comment les professeurs-documentalistes peuvent-ils s’emparer de l’IA pour développer les compétences de lecture des élèves, au collège ou au lycée ? Appuyez-vous sur les ressources ci-dessous ainsi que sur vos propres connaissances de la profession et des terrains des CDI, vos représentations du numérique, de l’éducation, de la médiation, vos capacités à intégrer des outils issus d’innovations technologiques. L’objectif est de concevoir un scénario visant à renforcer les compétences de lecture des élèves.
Ressources :
● Missions des professeurs documentalistes inhérentes au développement de la lecture chez les élèves (Circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017).
● Lettre de rentrée des IA-IPR Établissements et Vie scolaire de l’Académie de Montpellier – Année scolaire 2024-2025
● APDEN Wikinotions : https://wikinotions.apden.org/index.php
● EDUSCOL : cadre de référence des compétences numériques (CRCN) https://eduscol.education.fr/document/20392/download
● LEGIFRANCE : socle commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCC) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038895266
Les étudiants ont commencé à travailler en autonomie d’abord durant une heure et demie en TD puis ont pu rendre leur travail plus tard, trois semaines après.
Séances préalables : éducation à l’IA
Les scénarios proposés commencent toujours par une ou plusieurs séances introductives visant à définir ce qu’est l’IA et à en comprendre les principes de base. Lors de ces premières séances, le professeur-documentaliste choisit de mettre l’accent sur un ou plusieurs aspects :
Les modalités d’interrogation des IA
Pour rédiger des prompts efficaces et interagir avec une IA, l’usager devra être précis, clair et fournir des détails sur sa demande. Un prompt bien structuré inclut des informations spécifiques sur un sujet. Tant que la réponse n’est pas satisfaisante, l’usager ajuste et affine sa demande.
Le principe d’apprentissage automatique par l’analyse de données
L’IA analyse de vastes ensembles de données pour identifier des modèles et des tendances en suivant des règles mathématiques. Cette approche est connue sous le nom de machine learning, elle permet à l’IA de s’améliorer au fil du temps.
Des exemples d’utilisations des IA dans la vie quotidienne
– Moteurs de recherche : Google, Ecosia, Bing… dans les recherches effectuées sur le web, les résultats sont triés en fonction de leur pertinence mais aussi en fonction des habitudes de recherche de l’utilisateur.
– Assistants vocaux : Siri, Alexa, Google Assistant sont des outils qui utilisent l’IA pour reconnaître la voix, convertir la parole en texte et interpréter la demande. Ils analysent les requêtes pour proposer des réponses adaptées.
– Traducteurs automatiques : Google traduction, DeepL, Reverso sont des outils entraînés sur des millions de textes multilingues permettant des traductions instantanées de textes.
– Traitement et génération d’images : l’IA est utilisée dans de nombreux outils de retouche et de création d’images.
Les limites et les enjeux des outils IA
La boîte noire des IA désigne le flou, l’opacité et la complexité des mécanismes internes qui régissent leur fonctionnement. Ce côté obscur repose notamment sur plusieurs facteurs : l’opacité des algorithmes, le manque d’accessibilité et de vérifiabilité des données d’apprentissage, la collecte et l’exploitation de données personnelles, et la reproduction de biais présents dans les données d’apprentissages.
Les questions éthiques soulevées par l’IA
Ces questions touchent notamment au respect de la confidentialité et à la protection des données à caractère personnel (risque d’atteinte à la vie privée) ; à la nécessité de transparence dans les décisions automatisées (risque de discrimination) ; à l’impact de l’IA sur les métiers et sur la société (risque d’automatisation des tâches et de perte d’emplois). Dans ce contexte numérique, l’école fait face à un double défi. D’une part, elle doit permettre aux élèves de développer les connaissances et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans une société de l’information numérique. D’autre part, elle doit veiller à encadrer les usages numériques par des pratiques responsables et respectueuses des droits de chacun.
Une attention particulière est portée aux données sensibles et aux données scolaires. Par données sensibles, on entend des données à caractère personnel concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé, l’orientation sexuelle, les données génétiques et biométriques.
D’un point de vue juridique, les données scolaires des élèves ne sont pas considérées comme des données sensibles (Braun, Kerdelhué, 2023). Ce sont des données collectées auprès d’enfants mineurs dont le respect de la vie privée est inscrit dans la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE). Or, la plupart des IA disponibles ne respectent pas le RGPD. Les bonnes pratiques d’usage consistent à créer un compte enseignant (avec une adresse mail académique) ou un compte classe, à informer le chef d’établissement de l’usage de l’IA en classe, à réaliser l’inscription de l’outil numérique au registre de l’établissement et à informer les utilisateurs des risques encourus.
Ces premières séances incluent des exercices pratiques permettant aux élèves de tester différents outils d’IA, de se familiariser avec eux d’analyser leurs résultats et d’apprendre à formuler des requêtes pertinentes.
Comment intégrer l’IA dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au CDI ? Voici cinq scénarios pédagogiques innovants, adaptés pour cette publication. Chacun détaille les objectifs, les compétences travaillées et les modalités de mise en œuvre, tout en mettant en lumière les points de vigilance et les limites à anticiper. Ces activités, bien que conçues pour un niveau précis, restent modulables en fonction des besoins pédagogiques.
– Scénario 1 : Écriture créative et lecture attentive avec l’intelligence artificielle générative (IAG)
– Scénario 2 : L’IA comme outil de recommandation de lectures
– Scénario 3 : La lecture augmentée : l’IA comme outil de compréhension et d’analyse
– Scénario 4 : Lire à haute voix, lecture accompagnée par l’IA
– Scénario 5 : Écrire une lettre de motivation : corrections et reformulations guidées par l’IA
Scénario 1
Écriture créative et lecture attentive avec une intelligence artificielle générative (IAG) – Eva Bailloud, Marion Durr et Anna Lewicki
Ce scénario invite les élèves à s’engager dans une activité d’écriture créative en interaction avec une IAG. L’objectif est double : leur faire découvrir les mécanismes de la narration et développer leur esprit critique face aux productions d’un agent non humain. À travers ce processus de coécriture, les élèves sont amenés à formuler, reformuler et à affiner leurs idées, tout en portant une attention particulière à la cohérence et à la qualité des textes générés. Ce scénario peut donner lieu à divers prolongements pédagogiques, tels qu’une comparaison entre productions humaines et générées par IA ou encore un débat sur le rôle de l’intelligence artificielle dans la création littéraire.
Niveau scolaire :
Collège, élèves de 5e
Modalités pédagogiques :
2 heures. En demi groupe.
Matériel et ressources :
● Textes littéraires : Les romans Croc-Blanc de Jack London, Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach et Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier.
● Guide d’auto-analyse (document élève)
● Postes informatiques connectés à internet
● IA ChatGPT (OpenAI) ChatGPT permet de créer des récits cohérents. Les élèves peuvent poser des questions, demander des reformulations, proposer des suggestions d’amélioration.
Objectifs pédagogiques :
▶ Travailler la structure narrative d’un texte
▶ Développer des compétences en écriture créative
▶ Renforcer la lecture attentive et l’analyse de texte
▶ Apprendre à interagir efficacement avec une IAG
▶ Renforcer l’esprit critique face aux productions
de l’IAG
Déroulement de la séance – 2 heures
Étape 1 : Lecture et analyse des textes supports, durée 30 minutes
Lecture de trois extraits de romans d’aventure. Analyse collective de la structure narrative (cadre, personnages, action).
Étape 2 : Lancement de la production, durée 20 minutes
Les élèves choisissent une des trois premières phrases parmi les textes lus et rédigent des prompts pour générer une suite avec l’IA.
Étape 3 : Réécriture assistée, durée 30 minutes
Les élèves affinent leur production en dialoguant avec l’IA. L’enseignant les guide dans l’élaboration de prompts efficaces.
Étape 4 : Guide d’auto-analyse, durée 20 minutes
À l’aide du guide auto-analyse, les élèves évaluent leur texte : cohérence, logique des événements, pertinence de l’IA.
Étape 5 : Lecture à voix haute et échanges, durée 20 minutes
Lecture des textes coproduits, commentaires sur les intentions narratives, les apports et les limites de l’IA.
Document élève : guide d’auto-analyse
Questions proposées : L’histoire a-t-elle un sens ? Les personnages sont-ils bien présentés ? Le déroulement des événements est-il logique ? L’IA a-t-elle bien compris ton intention ? Qu’aurais-tu envie de modifier ? Pourquoi ?
Limites et points d’attention sur l’accompagnement pédagogique :
Certains élèves peuvent rencontrer des difficultés à formuler des prompts efficaces ; un accompagnement est nécessaire.
Les textes générés peuvent comporter des incohérences ou des biais. Il est important d’encourager la prise de recul et la réécriture.
L’IAG ne doit pas être perçue comme une source d’autorité ou de vérité littéraire.
Scénario 2
L’IA vous recommande une lecture – Salomé Blachère
Choisir un livre en autonomie peut constituer un véritable défi pour un jeune. Ce travail vise à développer l’autonomie des élèves dans leur démarche de recherche de livres adaptés à leurs goûts et à leur niveau de lecture.
Niveau scolaire :
Collège : 3e
Modalités pédagogiques :
2 heures. En demi-groupe.
Matériel et ressources :
● Autoportrait de lecteur (document élève)
● Liste d’ouvrages disponibles au CDI au format PDF
● Postes informatiques connectés à internet
● IA Perplexity
Objectifs pédagogiques :
▶ Apprendre à rédiger un prompt et télécharger,y joindre un document PDF
▶ Interagir avec une IAG de manière active : utiliser les outils numériques pour rechercher un livre
▶ Comprendre le fonctionnement d’une IA
▶ Se connaître lecteur, encourager la réflexionsur ses goûts littéraires
▶ Développer l’autonomie des élèves dansla recherche de livres
▶ Se repérer dans l’espace documentaire
Déroulement de la séance – 2 heures
Étape 1 : Préférences de lecture et expression des attentes, durée 20 minutes
Les élèves réfléchissent à leurs goûts littéraires (genres, thématiques, formats). Ils complètent une fiche personnelle pour exprimer leurs préférences (voir document élève). Cette étape leur permet de formuler plus facilement leur demande à l’IA.
Étape 2 : Présentation d’une liste d’ouvrages, durée 10 minutes
Le professeur-documentaliste présente une liste d’ouvrages disponibles au CDI.
Cette liste contient : titres, auteurs, résumés, mots-clés, genres, formats, nombre de pages, cotes des documents. Les élèves sont invités à télécharger ce fichier au format PDF afin de l’utiliser dans la suite de l’activité.
Étape 3 : Formulation d’un prompt personnalisé, durée 20 minutes
Chaque élève rédige un prompt adapté à son profil de lecteur et à ses attentes. Des exemples de formulations sont proposés pour les aider (lecteur passionné, lecteur réticent, recherche ciblée…). Le prompt est soumis à l’IA, accompagné du fichier PDF.
Étape 4 : Analyse des propositions générées, durée 25 minutes
Les élèves lisent les réponses de l’IA : suggestions de livres, résumés, cotes. Ils comparent les titres proposés à leurs attentes. Ils choisissent un livre qui leur semble adapté et partent à sa recherche dans le CDI.
Étape 5 : Validation du choix et lecture exploratoire, durée 15 minutes
L’élève commence la lecture du livre choisi afin de valider ou non son intérêt. En cas de déception, il peut explorer une autre proposition ou ajuster son prompt.
Étape 6 : Bilan critique, durée 30 minutes
Temps d’échange : L’IA a-t-elle orienté les choix de lecture ? Les prompts ont-ils été efficaces ? Quelle place donner à l’IA dans les pratiques de recommandations de lectures ? Chaque élève partage son expérience, ses éventuelles difficultés et son avis sur l’intérêt d’utiliser une IAG pour le conseil en lecture.
Document élève :
Les élèves remplissent une fiche « autoportrait de lecteur » sur laquelle ils sont amenés à noter le ou les genres de lectures qu’ils affectionnent plus particulièrement, le livre qu’ils ont lu récemment, celui qu’ils ont aimé ou celui qu’ils ont détesté. Comment choisissent-ils leurs lectures en général ?
Limites et points d’attention sur l’accompagnement pédagogique :
Une attention devra être portée sur la rédaction des prompts de manière à ce que les éléments demandés puissent être retrouvés par l’IA dans la liste fournie. Finalement, les suggestions générées par l’IA ne sont pas forcément parfaites, les élèves devront également se baser sur leur propre jugement pour choisir.
Scénario 3
La lecture augmentée : l’IA comme outil de compréhension et d’analyse – Inès Debette, Morgane Guillet et Suzanne Conte
Dans cette activité, l’utilisation de l’IAG comme outil de compréhension transforme la lecture en une activité dynamique. Les élèves construisent eux-mêmes leur savoir et leur compréhension du texte étudié. Ils développent leur esprit critique, interrogent la profondeur de leurs réponses, formulent des questions, interrogent différentes interprétations possibles du texte. L’interaction avec les IA demande aux élèves d’affiner leurs questions pour obtenir des réponses pertinentes, cela renforce leur capacité à poser des questions précises.
Niveau scolaire :
Lycée professionnel : 1re professionnelle ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
Modalités pédagogiques :
2 heures. En demi-groupe.
Matériel et ressources :
● Textes littéraires : Le roman L’Étranger d’Albert Camus
● Guide d’auto-analyse (document élève)
● Postes informatiques connectés à internet
● Possibilité de comparer les réponses de 2 IA : Copilot (Microsoft) et Le Chat – Mistral AI
Objectifs pédagogiques :
▶ Utiliser l’IA pour améliorer la compréhension et l’analyse d’un texte littéraire
▶ Apprendre à formuler des questions précises et pertinentes pour interagir avec l’IA
▶ Développer des compétences en analyse littéraire et en rédaction
▶ Encourager la réflexion critique sur l’utilisation des outils numériques dans l’apprentissage
Déroulement de la séance – 2 heures
Étape 1 : Lecture guidée du chapitre 1 de L’Étranger d’A. Camus, durée 20 minutes
Lecture collective ou individuelle du premier chapitre de L’Étranger. L’enseignant accompagne les élèves pour relever les éléments clés : style, contexte, personnages, ambiance. L’attention est portée sur les phrases courtes, les silences, l’impassibilité de Meursault.
Étape 2 : Questionnaire de compréhension, durée 25 minutes
Chaque élève remplit un questionnaire structuré (voir document élève) portant sur : le vocabulaire spécifique (asile, veillée, bière…), le comportement du personnage principal, le contexte historique et culturel, les procédés d’écriture (style minimaliste, effets de rythme), les thèmes principaux (mort, absurdité, décalage émotionnel).
Étape 3 : Interrogation de l’IA, durée 25 minutes
Les élèves soumettent leurs questions à une IAG pour : vérifier leurs réponses, approfondir certains points, interroger le style de Camus, explorer le contexte historique ou lexical du texte. Ils comparent les réponses de l’IA à leurs propres analyses et formulent de nouvelles questions en réponse aux pistes ouvertes par l’IA.
Étape 4 : Discussion et mise en perspective, durée 25 minutes
Échange en petits groupes : quelles différences entre leur lecture et l’interprétation proposée par l’IA ? L’IA a-t-elle aidé à mieux comprendre le texte ou a-t-elle biaisé leur regard ? L’intention de l’auteur est-elle bien rendue par l’IA ?
Étape 5 : Restitution et bilan, durée 25 minutes
Restitution orale des analyses comparées. Chaque élève exprime son point de vue sur l’apport de l’IA dans l’étude littéraire : a-t-elle permis une lecture plus riche ? A-t-elle fait apparaître de nouveaux questionnements ? Quelles limites ou dérives possibles dans l’usage d’une IAG face à un texte littéraire complexe ? Possibilité d’ouvrir la réflexion sur les différences entre interprétation humaine et générée, et la place du lecteur dans l’acte de lecture.
Document élève :
Questionnaire sur le contexte historique et philosophique, le vocabulaire employé par l’auteur, les choix stylistiques de Camus (phrases courtes et simples), les thèmes principaux du chapitre (l’absurde, l’indifférence, la mort), l’attitude du personnage de Meursault.
Limites et points d’attention sur l’accompagnement pédagogique :
Le professeur-documentaliste veille à ce que les élèves formulent correctement leurs prompts avec clarté et précision. Il les encourage à reformuler des questions incomplètes ou trop générales. L’IA peut donner des réponses trop générales ou mal interpréter le texte. L’idée est de réfléchir avec l’IA et ne pas prendre comme vérité absolue les réponses générées.
Scénario 4
Lire à haute voix, lecture accompagnée par l’IA – Yasmine Dezombre et Martin Legendre
Certaines IA peuvent accompagner et corriger la lecture à haute voix en temps réel en analysant la prononciation, le rythme, l’intonation et la fluidité grâce à la reconnaissance vocale. Elles permettent un perfectionnement notamment dans la lecture en langue étrangère. Dans cet exemple, l’IA est utilisée pour améliorer son anglais. L’élève travaille la compréhension de texte et l’acquisition de vocabulaire en anglais, il travaille l’intonation, l’accentuation, le rythme et la fluidité de lecture, il travaille ses compétences en termes de lecture expressive et de prononciation. Ce travail lui permet d’identifier ses propres difficultés et progrès.
Niveau scolaire :
Lycée : 2de
Modalités pédagogiques :
2 heures. En demi-groupe.
Matériel et ressources :
● Tableau de progression (document élève)
● Tablettes numériques ou téléphones mobiles
● IA Google read along
Pour fonctionner correctement, l’application doit accéder au micro du lecteur.
Objectifs pédagogiques :
▶ Utiliser une IA pour s’entraîner à lire à haute voix
▶ Améliorer la prononciation et la fluidité en anglais
▶ Renforcer la compréhension écrite et orale
▶ Développer l’autonomie et la confiance en lecture
▶ Travailler l’écoute active et la collaboration entre pairs
Déroulement de la séance – 2 heures
Étape 1 : Présentation de l’application et démonstration, durée 15 minutes
Le professeur-documentaliste présente Google Read Along (fonctionnement, utilité, objectifs). Démonstration avec un extrait de texte lu à voix haute. Explication du système de reconnaissance vocale et de feedback immédiat (prononciation correcte, mots mal prononcés).
Étape 2 : Choix et lecture individuelle, durée 30 minutes
Chaque élève choisit une histoire adaptée à son niveau dans l’application. Lecture individuelle à voix haute via l’outil. L’élève note les mots difficiles rencontrés sur la fiche de suivi (voir document élève). Il peut réécouter la bonne prononciation et répéter autant que nécessaire.
Étape 3 : Travail sur les points de difficulté, durée 15 minutes
Les élèves repassent sur les phrases ou les mots compliqués. Ils s’entraînent à les répéter jusqu’à amélioration. L’application leur propose un accompagnement vocal (feedback, correction syllabique).
Étape 4 : Travail en binômes, durée 30 minutes
Formation de binômes d’écoute croisée : l’élève lit son texte à un camarade sans support visuel. Le camarade note les points à améliorer : hésitations, erreurs, fluidité. Retour oral et bienveillant du binôme.
Étape 5 : Partage des ressentis et lecture valorisante, durée 30 minutes
Échange collectif sur l’activité : qu’est-ce qui a été difficile ? Quel mot ou quelle phrase a posé problème, et comment l’ai-je surmonté ? Chaque élève lit une phrase difficile qu’il a réussi à mieux prononcer. Les plus confiants peuvent lire une courte histoire à toute la classe pour valoriser leurs progrès.
Document élève :
Dans un tableau, l’élève note les éléments suivants : le titre du texte travaillé, les éventuelles difficultés rencontrées lors des différentes lectures : difficultés de prononciation, mots ou expressions inconnus, erreurs récurrentes, les recherches effectuées pour comprendre le texte, le temps de lecture, les progrès et améliorations observés.
Limites et points d’attention sur l’accompagnement pédagogique :
Les enseignants veillent à ce que les élèves choisissent des textes adaptés à leur niveau. Certains élèves peuvent se sentir mal à l’aise avec la lecture à haute voix : prévoir un environnement calme, ou recourir à de petites salles peut être une solution. Les professeurs veilleront à compléter les retours effectués par l’IA sur la lecture par des conseils humains. Sensibiliser les élèves à ce que l’outil IA est un assistant qui peut faire des erreurs ou standardiser la langue anglaise en privilégiant une certaine prononciation.
Scénario 5
Écrire une lettre de motivation : corrections et reformulations guidées par l’IA – Cécile Heckel
L’IA générative de textes peut permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences en termes de production écrite, de vocabulaire, de style, de grammaire, de précision du discours. Dans cet exemple, plusieurs IAG sont utilisées dans le but de corriger et d’améliorer un texte écrit par un élève. Le texte produit est une lettre de motivation dans le cas d’une recherche de stage. L’élève apprend à maîtriser et à respecter les normes et la structure d’une lettre de motivation. Il compare et analyse sa production écrite et les nouveaux textes proposés par les IA. Il affine son propre texte en s’appuyant sur les suggestions des IA.
Niveau scolaire :
Collège : 4e ou 3e
Modalités pédagogiques :
2 heures. En demi-groupe.
Matériel et ressources :
● Degré de prise en compte de l’IA dans la rédaction (document élève)
● Utilisation de postes informatiques
● Traitement de texte
● IA au choix : ChatGPT (OpenAI), Gemini, Copilot (Microsoft) ou Le Chat – Mistral AI
Objectifs pédagogiques :
▶ Développer l’esprit critique face aux productions de textes générés par l’IA
▶ Analyser les différences de style et de cohérence entre un texte rédigé par un humain et un ou plusieurs textes générés par des IA
▶ Comprendre les forces et les limites de l’IA dans la production écrite
▶ Travailler la production écrite et la reformulation
▶ Comparer les suggestions de deux IA différentes
Déroulement de la séance – 2 heures
Étape 1 : Présentation des attendus et exemples de lettres de motivation, durée 20 minutes
Le professeur-documentaliste rappelle le contexte du stage en entreprise. Présentation des éléments obligatoires à insérer dans une lettre de motivation : coordonnées, objet, accroche, connaissance de l’entreprise, valorisation du profil, formule de fin. Lecture et analyse collective de modèles de lettres (bonnes et mauvaises pratiques).
Étape 2 : Rédaction individuelle, durée 25 minutes
Les élèves rédigent leur propre lettre de motivation en s’appuyant sur la structure étudiée. L’enseignant fournit une fiche d’aide à la rédaction (voir document élève).
Étape 3 : Relecture anonyme entre pairs, durée 20 minutes
Les lettres sont échangées. Chaque élève lit la lettre d’un camarade et propose des commentaires de fond et de forme (formulations, clarté, logique, ton, orthographe). Restitution orale collective : mise en commun des remarques fréquentes et des difficultés rencontrées.
Étape 4 : Révision individuelle, durée 15 minutes
Les lettres sont rendues à leur auteur. Chacun les corrige ou complète à partir des retours de son pair et des échanges en groupe. Un temps de réflexion écrit permet d’identifier les difficultés personnelles rencontrées lors de la rédaction.
Étape 5 : Soumission à deux IA, durée 20 minutes
Les élèves soumettent leur lettre à deux IA génératives différentes au choix (ChatGPT, Mistral, Gemini, Copilot…). Ils comparent les suggestions faites par les deux IA. Ils choisissent les modifications pertinentes et justifient par écrit ce qu’ils conservent ou modifient, et pourquoi.
Étape 6 : Finalisation et auto-évaluation, durée 20 minutes
Chaque élève finalise sa version définitive de la lettre. Il répond ensuite à un questionnaire réflexif : Qu’ai-je modifié grâce aux IA ? Les IA ont-elles été utiles ? Quelles suggestions étaient peu pertinentes ? Mon texte est-il plus clair ou convaincant ? Pourquoi ?
Document élève :
Les élèves rendent visibles les différentes étapes de leur travail. Ils listent les différences entre leur texte initial et les versions améliorées. Ils précisent systématiquement le degré de prise en compte des IA : suggestions de correction, orthographe, grammaire, style, fluidité, clarté, reformulation, apport de précisions, réécriture complète…
Limites et points d’attention sur l’accompagnement pédagogique :
Le professeur-documentaliste insistera pour que les élèves justifient leurs choix de suivre ou non les indications d’une IA. Il s’assurera que les élèves comprennent les suggestions proposées et se les approprient. Il insistera pour que toutes les corrections proposées par les IA ne soient pas forcément intégrées car elles peuvent être inadaptées, non pertinentes ou peuvent mériter d’être discutées. Certains élèves pourraient être tentés de déléguer l’écriture à l’IA. L’enseignant questionne les élèves sur la place de la réflexion personnelle dans ce type d’exercice.
Ces scénarios proposent des approches pédagogiques actives et engageantes. Ils s’appuient sur des pratiques traditionnelles et intègrent l’IA de manière à montrer aux élèves comment utiliser et interroger ces outils. L’intégration de l’IA au CDI ne se résume pas à une simple modernisation des pratiques. Elle implique un changement profond dans l’approche pédagogique. Le professeur-documentaliste joue un rôle clé dans cette transition en aidant les élèves à développer leur esprit critique et leur autonomie face aux outils numériques. Des défis subsistent toutefois : Comment former les enseignants à ces nouvelles pratiques ? Quels cadres éthiques mettre en place ? Comment réfléchir avec les élèves au statut légal des textes générés par l’IA ? Qui en est l’auteur ? Quels outils privilégier pour minimiser l’exposition des données personnelles ? Pour aller plus loin, il nous paraît pertinent d’expérimenter ces scénarios et d’autres encore et d’évaluer leur impact sur les apprentissages.