Cette litanie de dates montre l’évolution de la prise de conscience du caractère génocidaire de la traite négrière telle qu’elle s’est mise en place à partir du 15e siècle2. La loi Taubira parle bien de cet aspect de l’esclavage dans l’article 1 : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. » L’article 2 évoque son enseignement à l’école : « Les programmes scolaires et les programmes de recherche en Histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent .»

Repères pédagogiques
• L’esclavage et les traites sont au programme de 4e, dans le thème 1 : le 18e s., expansions, Lumières et révolutions. Un quart du programme d’Histoire est effectivement consacré aux traites négrières au 18e siècle, soit à l’apogée de ce trafic. Il est explicitement recommandé dans les programmes de ne traiter que cette partie, et non pas les origines de l’esclavage ou sa mise en place.
• En classe de 2de, l’esclavage est traité surtout du point de vue des mouvements abolitionnistes, comme partie des mouvements de liberté des nations au 19e siècle, comme le précise le thème 5 du programme : Révolutions, libertés, nations, à l’aube de l’époque contemporaine.
Sites institutionnels
La création d’un comité chargé d’organiser les lieux et actions de commémoration de l’esclavage et de la traite est ordonnée par la loi Taubira. Après plusieurs changements de nom, ce comité devient en 2013 le Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage (CNMHE). www.cnmhe.fr/
Ce site est très utile notamment pour toutes les informations législatives, et le calendrier des événements autour de la commémoration, notamment à travers sa page :
www.esclavage-memoire.com/
Attention, certaines pages ne sont pas rafraîchies depuis quelques temps, et la rubrique Enseignement est un peu maigre.
Projet de fondation pour la mémoire de l’esclavage www.lemonde.fr/politique/article/2018/04/27/une-fondation-pour-la-memoire-de-l-esclavage-sera-creee-en-2018-a-annonce-emmanuel-macron_5291735_823448.html
Organisation des Nations Unies
Le site web de l’ONU regroupe sur une page l’ensemble des ressources qu’elle propose à l’occasion de sa propre journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 2 décembre. On y trouve de nombreux textes de lois, déclarations d’intention et qui concernent aussi beaucoup l’esclavage moderne. Il peut être toutefois intéressant de signaler la dimension internationale de la commémoration. www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/index.shtml
Un laboratoire du CNRS travaille sur les questions de l’esclavage, le Centre International de Recherches sur l’Esclavage (CIRESC). Sur son site, on trouve les travaux du laboratoire www.esclavages.cnrs.fr, ainsi qu’un lien vers un site pédagogique http://education.eurescl.eu . Ce dernier n’est pas vraiment à jour, mais certaines pistes peuvent donner des idées de parcours d’expositions.
Les musées
Mémorial de l’abolition de l’esclavage, Nantes. La ville de Nantes possède un grand mémorial de l’esclavage, en lien bien entendu avec le passé de port négrier de la ville.
http://memorial.nantes.fr/
Le site propose des infos pratiques sur le musée, ainsi que des éléments pour aider les enseignants à préparer leur visite.
www.chateaunantes.fr/fr/enseignants.
Différents parcours sont proposés, du primaire au lycée. Une sélection de ressources accompagne ces parcours d’exposition. Des expositions itinérantes peuvent également être empruntées.
Association Les anneaux de la mémoire, Nantes. Cette association, créée à la suite de l’exposition éponyme, travaille sur les mémoires de la traite négrière et l’ouverture culturelle entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. http://anneauxdelamemoire.org/
Elle propose également la location de matériel d’exposition, mallettes, expositions, etc.
http://anneauxdelamemoire.org/outils-de-mediation/outils-pedagogiques/
Le mémorial ACTe, Pointe-à-Pitre
Ce mémorial, construit à la place d’une ancienne usine sucrière, est également un lieu d’expression de la culture caribéenne et programme, en plus des expositions permanentes et temporaires, des rencontres, concerts, contes, conférence, etc.
http://memorial-acte.fr/
La route des abolitions de l’esclavage – Pôle mémoriel du Grand-Est. Ce pôle mémoriel est en fait un réseau de musées ou de lieux de mémoire situés dans l’Est de la France. Il est une association loi 1901 reconnue d’intérêt générale. Sur le site, on trouve l’ensemble des lieux visitables, mais également des ressources mises à disposition, notamment des expositions en prêt et des bibliographies. www.abolitions.org
Quelques musées de ce réseau ont une page Facebook, notamment la maison de la Négritude à Champagney www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
et l’espace muséographique Victor Schoelcher, à Fessenheim www.facebook.com/museeschoelcher/
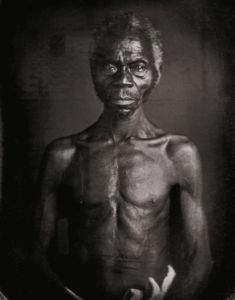
Déroulé de cours en ligne
Un déroulé de cours sur Bordeaux et le commerce triangulaire. http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/bordeaux_et_commerce_triangulaire#attachments
« Les chemins d’une liberté, esclavage et abolitions » http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp/bordeaux_et_commerce_triangulaire#attachments
Dossiers pédagogiques
https://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/cm1/dossier/l-esclavage-comprendre-son-histoire
Dossier très complet autour de l’esclavage. Attention, il est à destination d’élèves de CM1, certains documents ne seront pas adaptés notamment les dessins animés « Il était une fois… ». Pour le reste, le format court des articles et des vidéos se prêtent très bien à une exposition au CDI, en collège.
www.inrap.fr/dossier-actualite/sur-les-traces-de-l-esclavage-colonial
Un dossier constitué par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives sur les fouilles de sites liés à l’esclavage : usines sucrières, plantations, etc.
www.esclavage-martinique.com/
Chronologie de l’histoire de l’esclavage en Martinique.
https://gallica.bnf.fr/essentiels/parcours-pedagogiques/esclavage
Ce parcours s’appuie sur les documents de Gallica (iconographie mais également littérature) pour créer un parcours pédagogique avec notamment des questions posées aux lecteurs, qui doivent trouver la réponse dans les documents. Plutôt pour le lycée.
Site Histoire par l’Image www.histoire-image.org/fr/albums/traite-noirs
Expositions virtuelles
http://exposvirtuelles.charente-maritime.fr/fr/expositions/la-traite-negriere-rochelaise-au-xviiie-siecle
Exposition virtuelle qui raconte cette fois-ci l’activité négrière de La Rochelle, autre grand port négrier français. On trouve des cartes, des panneaux explicatifs, des fac-similés de documents d’époque, type registres de commerces, etc.
La visite virtuelle d’une habitation sucrerie en Martinique, créée par quatre enseignants. Fiches pédagogiques téléchargeables, iconographie. Une ressource agréable à explorer.
www.habitation-sucrerie.fr/index.php?lang=fr
www.thinglink.com/scene/651720949619490817?buttonSource=viewLimits
Une carte Thing Link des principaux ports négriers français, avec des liens vers des ressources pédagogiques type FranceTV éducation. Idéal pour une mise à disposition sur un ordinateur en libre service lors d’une exposition dans l’établissement.



