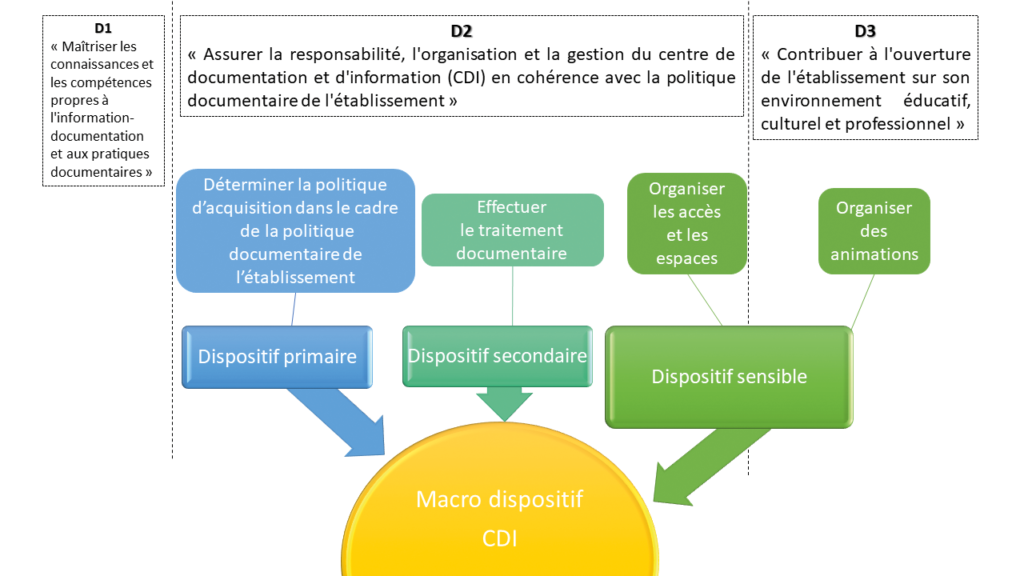La pédagogie actuelle va plutôt dans le sens de proposer un escape game aux élèves « fabriqué » par l‘enseignant pour assimiler des notions de cours. J’ai choisi un positionnement différent : entreprendre la création d’un « jeu d’évasion » avec des élèves ; cela semble ambitieux, mais c’est possible lorsqu’on a du temps. J’organise depuis longtemps des activités sous la forme de clubs et j’avais envie de « tester » ce phénomène à la mode avec des volontaires, notamment sa conception de A à Z. J’ai ainsi monté cet atelier sur inscription dans le cadre du FSE. Les élèves devaient venir une fois par semaine 1 h au CDI, de 12 h à 13 h, d’octobre à juin, ce qui constitue environ 20 séances. Une seule condition : être régulièrement présent à l’atelier, car ce projet n’est possible que sur la durée, avec un groupe assidu. Ce n’est pas une activité ponctuelle ; il faut du temps pour concevoir, parce qu’il est nécessaire de passer par toutes les étapes : découverte du jeu, choix d’un thème commun, création d’un scénario, d’énigmes, du décor, et mise en œuvre pour d’autres élèves. C’est aussi l’occasion de faire intervenir certaines compétences du socle commun : écrire une histoire ensemble, la raconter, faire des recherches, utiliser des logiciels pour les présentations, la retouche d’image…
Voici comment j’ai procédé pour aider ce groupe, composé de 10 élèves de 6e et 5e, à concevoir un jeu qu’ils ont intitulé « Sauvez Ariane ! ».
Un escape game, qu’est-ce que c’est ?
Les escape game viennent du Japon et se présentent à l’origine sous la forme de jeux vidéo appelés « escape room » : le but est de s’échapper, par la résolution d’énigmes, d’une pièce où le joueur est enfermé. Depuis quelque temps, des organismes en proposent en taille réelle, et des salles ouvrent un peu partout en France pour vivre une expérience en famille ou entre amis. Les participants, enfermés dans une salle à thème, doivent tenter de s’évader en moins de 60 minutes. Une série d’énigmes organisées et scénarisées les plongent dans un univers particulier et les incitent à collaborer pour se délivrer.
La première étape à observer dans le projet de conception d’un tel jeu est ainsi de bien définir ses principes. Les élèves inscrits à l’atelier en avaient entendu parler et se montraient très curieux, mais n’avaient jamais participé à une session réelle. Nous avons donc commencé par expliquer les grands principes et règles du jeu, puis listé le nombre de tâches à observer pour la création. La présentation de boîtes de jeux de société (il en existe beaucoup aujourd’hui sur des thèmes très variés) et l’acquisition de quelques livres ont permis d’enrichir leur représentation et la projection du projet. Quelques séances ont été consacrées à jouer ensemble, afin de se familiariser ; c’était indispensable, mais les élèves ont rapidement exprimé l’envie de se mettre à la réalisation.
D’emblée, un premier problème est apparu : le manque de temps. Les jeux proposés dans le commerce proposent des résolutions en une heure, mais en collège un cours ne dure que 55 min. Il fallait donc concevoir un jeu qui respecte cette condition, puis penser à le limiter à 4 ou 5 élèves pour une session, tout en respectant l’aspect collaboratif qui caractérise ce type de jeu, fondé sur l’entraide.
Choisir un thème
Avant de se lancer dans un scénario, il fallait imaginer un cadre précis, un thème qui détermine tout l’univers du jeu, un « fil rouge ». Il s’agit d’un choix très important, puisque tout le jeu est inévitablement en rapport avec ce thème de départ : décors, énigmes, trame narrative… et il est donc bien entendu impossible de le changer en cours de route. Une séance de brainstorming (remue-méninges) a permis de récolter les idées de chaque élève, même les plus farfelues. Beaucoup d’idées intéressantes ont émergé de ce premier travail : la fin du monde, les pirates (qui sera d’ailleurs le prochain thème), les jeux de cartes, la prison, un train « comme Agatha Christie », un bateau qui coule comme le Titanic… Mais le choix des élèves s’est porté à l’unanimité sur le thème de la « maison hantée », par « envie de faire peur ! » Une heure suffit pour ce travail préalable ; l’adhésion de tout le monde au thème conditionne grandement le succès du projet.
Écrire un scénario
Après le choix du thème, il était temps de créer une histoire logique, un scénario qui tienne debout avec des questions précises à se poser : pourquoi les joueurs sont-ils enfermés ? Que cherchent-ils ? Dans un escape game le terme de « scénario » est utilisé parce que le jeu est visuel et vécu. Pour la réalisation d’un film, le scénario est l’étape finale du développement du projet. Il combine l’écriture et les faits visuels ou visibles. Sans aller jusque-là, il est important de savoir où l’on va et pourquoi : le plongeon dans l’histoire, l’intrigue qui se déroule, a un rôle motivant pour les participants. Le scénario sera bien entendu étoffé, précisé, affiné au fur et à mesure de la construction des énigmes, mais il est essentiel d’en tisser la trame. J’ai donc séparé les élèves en trois groupes, afin de réfléchir à un scénario plausible, avec des contraintes pour les guider : un lieu, des personnages, une histoire courte, simple qui se serait passée dans cette maison avec 3 ou 4 protagonistes au maximum. Cela a donné lieu à plusieurs histoires que chaque groupe a présentées. Finalement, nous n’avons pas retenu une histoire en particulier, mais plutôt réalisé un mélange mariant les meilleures idées !
Cette étape est intéressante, parce qu’elle fait intervenir l’imagination des élèves avec les circonstances de la situation actuelle qui génère le jeu, les noms des personnages qu’ils vont incarner et une ébauche de décor. Ce scénario n’a pas besoin d’être long, mais il doit préciser les grandes lignes de l’histoire et l’événement qui motive la situation de jeu.
Créer des énigmes
Cette étape s’est avérée la plus compliquée à réaliser avec des élèves de ces niveaux (6e et 5e). Le jeu s’adressant à des collégiens du même âge que ceux qui le réalisent, il fallait créer des énigmes simples, ludiques, pas trop longues et en nombre limité, puisque le temps est lui aussi raccourci. Les élèves ont choisi de créer un jeu d’énigmes à résoudre en 30 minutes. Varier les plaisirs avec des jeux de lettres et de chiffres, des énigmes visibles et cachées, permet de surprendre, de maintenir l’attention/la tension. Les énigmes doivent être originalesm: il faut cacher des éléments, combiner, sans que ce ne soit trop linaire, même si quelques éléments restent solidaires, répartir et construire… pour mener à la solution par la résolution du code du cadenas qui tient fermée la porte d’Ariane. Cette étape de la conception du jeu est à la fois la plus cruciale et la plus compliquée à mettre en œuvre.
Durant trois à quatre séances, les élèves sont laissés libres dans leurs recherches d’énigmes avec, à leur disposition, des livres d’énigmes achetés pour l’occasion, Internet et leur imagination. Ils ont vite compris que le thème d’ensemble était primordial, en proposant des solutions le faisant systématiquement intervenir : charade pour trouver le mot « fantôme », mélange de lettres pour trouver le nom « Ariane », chiffres pour le code du cadenas…
Décorer
Dans cette aventure il est indispensable de consacrer une partie du CDI ou une petite salle attenante à ce jeu. J’ai la chance d’avoir trois petites salles vitrées dont une sera mobilisée pour l’installation d’un décor. Pour les élèves, la décoration est l’étape la plus amusante. Chercher des objets en rapport avec le thème choisi, c’est l’occasion aussi de réfléchir aux signes récurrents d’une maison hantée. Le décor à mettre en place ne coûte pas cherm: il suffit de récupérer du matériel dans son entourage, chez soi, dans la famille, auprès des enseignants. Ils ont joué le jeu en apportant des objets, semaine après semaine, consciencieusement.
Avant de lancer le jeu, il faut aussi imaginer la création d’une ambiance pour accueillir les joueurs : déguisements pour incarner les différents rôles de l’histoire, textes pour présenter le jeu et guider, bruitages, fonds sonores, musique… Il a fallu enregistrer leurs voix, les déguiser, faire des photos, des films. Ce sont des moments qui demandent aussi de la concentration et de l’investissement de la part des élèves pour être aboutis, et qui participent vivement à la mise en scène théâtrale. Des effets spéciaux sont aussi prévus : des jeux de lumière et des effets sonores diffusés par l’intermédiaire d’un téléphone portable.
Ensuite des cartes d’invitation, en fonction du thème, ont été créées pour inviter des élèves du collège à participer.
Scénario (suite)
Dans un escape game, il existe toujours un « maître du jeu » pour accueillir les joueurs. Ici, le majordome donnera les consignes et la servante racontera l’histoire tragique d’Ariane.
Pour augmenter le stress des joueurs, nous lançons un compte à rebours sur le vidéoprojecteur et un minuteur dans la salle de jeu.
Mise en œuvre
Des tests grandeur nature sont nécessaires. Les élèves ont donc invité des copains et copines à « tester ». Cela permet d’éviter les écueils. Nous avons par exemple réalisé que nous n’avions pas vraiment pensé à un éventuel échec des participants, et que prévoir des petits coups de pouce si les joueurs s’enlisent dans les énigmes était primordial. Nous avons donc décidé à ce moment-là qu’un des élèves serait le guide si les joueurs restaient bloqués, distillerait des indices, et pénétrerait même dans la salle si nécessaire.
Ces tests ont donc permis de repérer des erreurs de conception, mais surtout, les élèves ont pu s’entraîner à « jouer » leur rôle. Il faut noter qu’il est bien sûr impossible de réellement enfermer à clé des élèves dans une salle, donc nous sommes restés à proximité pour éviter qu’ils n’en sortent ; la salle étant par ailleurs vitrée, nous pouvions observer leur comportement.
L’apprentissage par la conception d’un jeu
Le but premier de cette activité n’était pas pédagogique, simplement ludique. Toutefois, rapidement, nous avons repéré les compétences qu’elle nécessite et construit. Ici, ce n’est pas le résultat qui est important, mais le cheminement pour y arriver et le degré d’implication des créateurs. La ludification, c’est-à-dire le fait de s’appuyer sur les mécanismes du jeu pour les convier dans les apprentissages, s’est inévitablement invitée.
Certaines compétences du socle ont été nécessaires et peuvent aussi être évaluées, parmi lesquelles :
• Compétence 1 – lire, écrire, dire : réflexion (créer une histoire, imaginer des énigmes, s’approprier une ambiance particulière) ; création (énigmes, décors), jeu d’acteur (expression orale, se mettre en scène) ; expression écrite (raconter, maîtriser la langue) ;
• Compétence 4 – la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : s’informer, se documenter (recherche sur le thème, énigmes…) ; s’approprier l’environnement informatique de travail (créer des dossiers pour enregistrer les travaux) ; créer, produire, traiter, exploiter des données (utiliser des logiciels de présentation) ;
• Compétence 7 – l’autonomie et l’initiative (s’impliquer dans un projet collectif, savoir travailler en équipe et prendre des initiatives pour le groupe).
Les élèves restent acteurs de leur apprentissage. Si, pendant le déroulement du jeu, ils développent entre eux une collaboration nécessaire, il en est de même pour sa création. Il est souvent question de la participation des élèves à un escape game pédagogique, moins de la création par des élèves. Ce qui m’intéressait n’était pas de faire passer des notions pédagogiques à tout prix, mais plutôt de développer un esprit de création et de collaboration par la conception. Au cours de discussions avec ce groupe, il ressort qu’ils ont beaucoup apprécié de « créer ensemble », alors que certains ne se connaissaient pas au départ. Ils avouent avoir eu un peu peur, ne sachant pas comment s’y prendre, mais, bien guidés, ils sont fiers du résultat et n’ont pas honte de le proposer aux élèves du collège. Ils ont aussi émis la volonté, après chaque session, d’expliquer aux joueurs leur cheminement vers ce résultat.

L’escape game
Scénario
Ariane est enfermée dans l’un des cachots de son manoir par le fantôme qui hante les lieux, alors qu’elle voulait partir le jour de ses 18 ans. Elle a besoin d’aide. Dans ce manoir vivent avec elle un majordome prénommé Edward et une vieille femme, Madeleine, la servante.
Les joueurs sont invités au manoir pour une fête et se retrouvent piégés par le fantôme qui les empêche de sortir eux aussi. Ils devront trouver le code du cadenas qui retient Ariane prisonnière pour pouvoir s’échapper. Sinon, ils resteront enfermés avec elle à jamais.
Décors
Le CDI
• Il sera plongé dans le noir : les volets seront fermés.
• Les tables à l’entrée seront recouvertes
de draps blancs.
• Des bougies seront parsemées sur les tables (bougies LED pour la sécurité) pour créer une lumière discrète, tamisée et sinistre.
Dans la salle de jeu :
• Installation d’un squelette, d’un crâne et
d’une main, prêtés par les professeurs de SVT.
• Des draps recouvrent les meubles et les tables.
• Une lampe ancienne prêtée par une maman donnera un peu de lumière avec quelques bougies.
• Disposition d’araignées en plastique sur
du coton pour figurer des toiles, un petit coffre, de vieilles clés, des livres anciens… pour créer une ambiance sinistre, poussiéreuse et digne d’un endroit abandonné depuis longtemps.
Scripte
Le majordome Edward :
« Messieurs, dames,
Je vous invite à vous asseoir. Nous allons vous raconter l’histoire d’Ariane, prisonnière de cette maison dans laquelle vous vous trouvez.
Délivrez-la ! »
Sur l’écran de projection du CDI, la photo de la famille d’Ariane est affichée dès leur entrée : les élèves ont préalablement posé pour la photo, incarnant les personnages, puis l’image a été « vieillie » grâce à un logiciel de retouche.
Lorsque les participants sont installés, un film démarre. C’est Madeleine, la servante, qui raconte l’histoire :
« Il y a bien longtemps de cela, une jeune fille du nom d’Ariane vivait seule avec son père, Edward, et moi-même dans ce manoir. Mais un jour, son père, jamais rentré de la chasse, a disparu. Le jour de ses 18 ans, elle décida de fuir le manoir pour le retrouver. Cependant, un être mystérieux, un fantôme, l’en empêcha et, depuis ce jour, Ariane est enfermée quelque part.
Votre mission aujourd’hui est de trouver le code du cadenas qui la délivrera et vous pourrez ensuite partir. »
Puis le majordome reprend la parole :
« Messieurs, dames,
Je vous invite à vous rendre dans cette salle. Plusieurs énigmes vous y attendent. Le but est de retrouver le code du cadenas qui délivrera Ariane de sa prison. Servez-vous du tableau pour prendre des notes.
Vous avez 30 minutes ! À vous de jouer ! »