Le mois de février est, aux États-Unis principalement, l’occasion de célébrer le Black History Month, le Mois de l’Histoire Noire, celle faite et vécue par les personnes noires. L’objectif de cette manifestation est de mettre en valeur nombre d’événements, de périodes et de représentations culturelles, notamment au sein du système éducatif, alors que ceux-ci sont presque systématiquement mis à l’index au profit de l’histoire globale, celles des blancs.
La littérature, comme témoin d’une époque donnée, est un outil privilégié pour mettre les jeunes lecteurs en contact avec ces histoires, qui sont parfois les leurs et celles dont ils héritent, consciemment ou non. La constitution d’un corpus permet alors de tenter de former un tout, ou du moins de combler certains manques cruciaux dans notre chronologie commune.
Grandes figures de l’Histoire Noire
La collection Histoire et Société chez Oskar Jeunesse est le principal pourvoyeur de récits historiques liés aux communautés noires. Pour n’en citer que quelques-uns, on trouvera dans son catalogue des titres documentaires romancés comme Harriet Tubman, la femme noire qui montra le chemin de la liberté, de Erik Simard, qui relate le parcours de cette ancienne esclave dont le combat contre l’abolition de l’esclavage a permis de mener vers la liberté nombre de ses compatriotes. Ensuite, c’est le portait de Rosa Parks, la femme noire qui refusa de se soumettre que ce même auteur dresse, au cœur de l’Amérique ségrégationniste. Le geste de cette Afro-Américaine, qui refusa de céder sa place dans le bus à un homme blanc, est au cœur de l’ouvrage, lequel s’attache à montrer comment cela marqua un élan important dans la lutte contre la ségrégation. Dans la même veine, Erik Simard ne pouvait bien évidemment pas oublier d’écrire sur Martin Luther King, dans un ouvrage intitulé Je suis un homme qui s’intéresse à son parcours à travers l’évolution d’un jeune membre du Ku Klux Klan, dont la pensée se transforme lorsqu’il découvre le discours de non-violence véhiculé par le célèbre pasteur. Yves Pinguilly quant à lui, dans son ouvrage Aimé Césaire, le nègre indélébile, porte un regard sur les colonies françaises, en l’occurrence la Martinique, en suivant le parcours et la pensée politique de l’anticolonialiste et poète. Enfin, nous pouvons évoquer le livre de Philippe Barbeau sur l’icône sud-africaine Nelson Mandela, humble serviteur de son peuple, qui revient tant sur son cheminement militant que sur son emprisonnement et sa carrière politique.
Par ailleurs, d’autres éditeurs et auteurs s’intéressent à certains événements ayant marqué l’Histoire Noire, notamment aux États-Unis. Un épisode semble avoir particulièrement marqué les esprits tout en s’intégrant aux impératifs de la littérature pour adolescents, de par l’âge des personnes concernées et l’environnement scolaire. Il s’agit de l’application, dans les années 1950, de la décision de la Cour Suprême de rendre inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques, forçant ainsi les établissements à accepter des élèves noirs. Sweet sixteen, d’Annelise Heurtier, met ainsi en scène la jeune Molly Costello (inspirée de la véritable Melba Patillo), qui fût l’une des neuf premiers étudiants noirs à intégrer un lycée jusque-là réservé aux élèves blancs, à Little Rock, dans l’Arkansas, État du sud des États-Unis où la tradition ségrégationniste était particulièrement bien ancrée. Robin Talley à son tour situe son roman 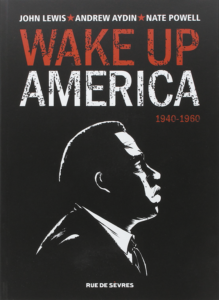 Des mensonges dans nos têtes à Davisburg en Virginie, et met en scène les personnages fictifs de Sarah Dunbar et neuf autres adolescents noirs lors de leur intégration dans un établissement scolaire réservé aux blancs. Ces deux romans utilisent le même processus pour montrer le rejet et le traitement infernal qu’ont subi ces étudiants. Les deux héroïnes noires, Molly et Sarah, voix principales de leurs récits respectifs, partagent dans les deux cas la narration avec une autre étudiante, blanche cette fois-ci. Grace dans Sweet Sixteen et Linda dans Des mensonges dans nos têtes sont au départ les pires ennemies de ce projet d’intégration des élèves noirs, mais leur rôle marque finalement l’évolution indispensable de la pensée blanche, de la ségrégation vers l’acceptation.
Des mensonges dans nos têtes à Davisburg en Virginie, et met en scène les personnages fictifs de Sarah Dunbar et neuf autres adolescents noirs lors de leur intégration dans un établissement scolaire réservé aux blancs. Ces deux romans utilisent le même processus pour montrer le rejet et le traitement infernal qu’ont subi ces étudiants. Les deux héroïnes noires, Molly et Sarah, voix principales de leurs récits respectifs, partagent dans les deux cas la narration avec une autre étudiante, blanche cette fois-ci. Grace dans Sweet Sixteen et Linda dans Des mensonges dans nos têtes sont au départ les pires ennemies de ce projet d’intégration des élèves noirs, mais leur rôle marque finalement l’évolution indispensable de la pensée blanche, de la ségrégation vers l’acceptation.
En bande dessinée, nous retiendrons l’œuvre en trois volumes Wake up America qui retrace, à travers le regard de l’ancien député démocrate John Lewis, compagnon de Martin Luther King, l’évolution de la société américaine et la conquête des droits civiques entre 1940 et 1965.
Grandes figures de la culture noire
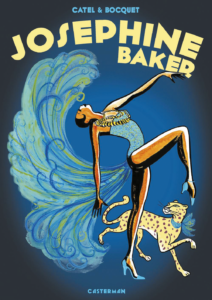 L’évocation d’une Histoire noire ne saurait être complète sans l’évocation d’une culture noire. Pourtant, la littérature s’attarde peu sur les artistes de manière générale et, en l’occurrence, c’est la musique américaine qui attire principalement les auteurs. Du côté des romans, Louis Atangana propose deux œuvres dans la collection doAdo aux éditions du Rouergue. Billie H., d’abord, décrit l’enfance de la jeune Eleanora qui grandit seule avec sa mère dans les années 1920 et deviendra la grande Billie Holiday. Dans la même veine, Jimi-X retrace la vie du célèbre guitariste Jimi Hendrix, des premières années passées dans la misère et la violence jusqu’au succès éphémère avant sa mort prématurée à seulement 27 ans.
L’évocation d’une Histoire noire ne saurait être complète sans l’évocation d’une culture noire. Pourtant, la littérature s’attarde peu sur les artistes de manière générale et, en l’occurrence, c’est la musique américaine qui attire principalement les auteurs. Du côté des romans, Louis Atangana propose deux œuvres dans la collection doAdo aux éditions du Rouergue. Billie H., d’abord, décrit l’enfance de la jeune Eleanora qui grandit seule avec sa mère dans les années 1920 et deviendra la grande Billie Holiday. Dans la même veine, Jimi-X retrace la vie du célèbre guitariste Jimi Hendrix, des premières années passées dans la misère et la violence jusqu’au succès éphémère avant sa mort prématurée à seulement 27 ans.
Enfin, deux bandes dessinées sur deux autres figures de la musique noire sont à évoquer. Coltrane, A Love Supreme de Paolo Parisi, d’abord, retrace de manière presque aléatoire et rythmée la carrière et les rencontres du saxophoniste John Coltrane. Et pour finir, le Josephine Baker, de Catel et Bocquet, parcourt la vie de celle qui est aujourd’hui connue comme la première star mondiale noire. Enfance, début de danseuse, militantisme, de Saint-Louis à Paris en passant par Cuba, les auteurs font ici le portait passionnant d’une artiste aux mille et une vies.
Vies anonymes à travers l’Histoire
Outre les récits s’intéressant à des personnages historiques, la littérature permet de figurer des événements à travers des personnages imaginaires ou des personnes inconnues. La situation américaine est particulièrement explorée et les auteurs s’intéressent ainsi à l’esclavage, la ségrégation et le combat pour les droits civiques.
Marche à l’étoile, d’Hélène Montarde, narre l’échappée d’un jeune esclave, Billy, qui relate son parcours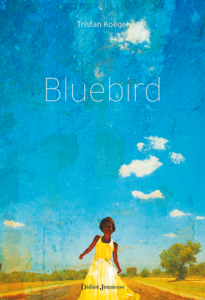 dans un carnet retrouvé plus tard par un étudiant américain, Jasper. Par ce biais, Jasper découvrira de manière concrète les conditions de vie de ses ancêtres. Les Larmes noires de Julius Lester, d’abord édité en littérature générale et désormais disponible au Livre de Poche Jeunesse, fait figure d’œuvre clé du récit sur l’esclavage. Il mêle réalité historique, en mettant en scène la plus grande vente d’esclaves jamais réalisée aux États-Unis, et l’imaginaire, en s’attardant sur le destin d’un personnage fictionnel, Emma, jeune esclave de 12 ans vendue à cette occasion. Autre roman majeur, Black boy de Richard Wright s’attaque à la question de la ségrégation dans les États du Sud où elle s’est appliquée le plus durement. Récit autobiographique, ce texte relate l’enfance et l’adolescence de l’auteur dans les années 1920 : la pauvreté, la violence des blancs, le Ku Klux Klan, le racisme ordinaire…
dans un carnet retrouvé plus tard par un étudiant américain, Jasper. Par ce biais, Jasper découvrira de manière concrète les conditions de vie de ses ancêtres. Les Larmes noires de Julius Lester, d’abord édité en littérature générale et désormais disponible au Livre de Poche Jeunesse, fait figure d’œuvre clé du récit sur l’esclavage. Il mêle réalité historique, en mettant en scène la plus grande vente d’esclaves jamais réalisée aux États-Unis, et l’imaginaire, en s’attardant sur le destin d’un personnage fictionnel, Emma, jeune esclave de 12 ans vendue à cette occasion. Autre roman majeur, Black boy de Richard Wright s’attaque à la question de la ségrégation dans les États du Sud où elle s’est appliquée le plus durement. Récit autobiographique, ce texte relate l’enfance et l’adolescence de l’auteur dans les années 1920 : la pauvreté, la violence des blancs, le Ku Klux Klan, le racisme ordinaire…
Tristan Koëgel, avec Bluebird, s’attaque aussi à cette thématique. Situant son récit un peu plus tard, dans les années 1940, l’auteur prend le prétexte de l’histoire de Minnie et de son père, musiciens itinérants, pour parcourir les États du Sud et proposer un regard sur la situation. Alors que l’esclavage est pourtant aboli, le traitement des noirs par les blancs demeure indigne dans cette contrée et dans les plantations de coton. Les deux personnages seront témoins de l’humiliation que subissent les travailleurs noirs et eux-mêmes, victimes du Ku Klux Klan, mais feront aussi de grandes rencontres. Enfin, Le Rêve de Sam de Florence Cadier explore également la thématique de la ségrégation et, au-delà, celle de la lutte pour les droits civiques, à travers son jeune personnage dont les parents sont assassinés pour avoir voulu voter et dont le parcours se fera en parallèle du combat mené par Martin Luther King.
Quelques auteurs se sont penchés sur l’histoire française, liée à la colonisation en Afrique et dans les territoires d’Outre-Mer. Sophie Chérer, par exemple, s’intéresse à une histoire singulière de l’île Bourbon (l’île de la Réunion actuelle). La Vraie Couleur de la vanille relate le destin d’Edmond Albus, qui y vécut au xixe siècle et dont les incroyables connaissances en botanique lui permirent de découvrir le secret de la pollinisation de la fleur de vanille. Par la suite, cette avancée assurant un important développement économique à l’île, le jeune Edmond, cet oublié de l’Histoire, fut bien évidemment spolié de sa découverte par les notables blancs qui ne pouvaient accepter que ce progrès fût le fait d’un esclave.
Autre thème traité dans quelques romans : l’utilisation des populations colonisées comme soldats pendant les conflits au cours desquels la France fût impliquée. Nous pouvons évoquer deux romans mettant en scène des combattants venus d’Afrique de l’ouest : Force noire de Guillaume Prévost et Le Chant noir des baleines de Nicolas Michel. Dans le premier, la rencontre, 70 ans plus tard, d’une jeune fille, Alma, et d’un vieux monsieur, Bakary Sakoro, permet la transmission de l’Histoire grâce au récit témoignage de ce dernier. Bakary vient du Mali et s’engage à 17 ans pour retrouver son frère en France. Comme souvent dans ce type d’œuvre, l’histoire personnelle du protagoniste est l’occasion de raconter la grande Histoire. Le lecteur voit ainsi défiler, à travers le regard du personnage, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le Chant noir des baleines fonctionne un peu de la même manière. Cette fois-ci, le jeune Léon découvre Tierno, un tirailleur sénégalais échoué sur la plage suite au naufrage du bateau qui le ramenait chez lui. Ce nouveau prétexte permet d’aborder sous un angle un peu différent le sort des populations colonisées et envoyées combattre pour un pays et contre un ennemi qui n’étaient pas les leurs.
Problématiques contemporaines
 Bien entendu, certains récits dont la trame est contemporaine mettent également en scène des personnages noirs, et permettent alors d’aborder des problématiques actuelles. Le racisme, en premier lieu. Entre chiens et loups, la série de Malorie Blackman, opte pour un positionnement particulier pour aborder la question des rapports conditionnés par la couleur de peau. En effet, l’auteure choisit de créer un monde inversé où les personnes noires, les Primas, seraient la catégorie dominante tandis que les personnes blanches, les Nihils, seraient la catégorie dominée. Ce procédé permet de mettre à jour les différences qui existent en termes de pouvoir, de richesse, d’accès à l’éducation, à l’emploi… Les intolérances et les inégalités décrites, dans la trame du roman et à travers l’histoire romantique qui se crée entre les deux protagonistes Callum et Séphy, sont l’occasion d’une démonstration du racisme structurel qui existe dans nos sociétés.
Bien entendu, certains récits dont la trame est contemporaine mettent également en scène des personnages noirs, et permettent alors d’aborder des problématiques actuelles. Le racisme, en premier lieu. Entre chiens et loups, la série de Malorie Blackman, opte pour un positionnement particulier pour aborder la question des rapports conditionnés par la couleur de peau. En effet, l’auteure choisit de créer un monde inversé où les personnes noires, les Primas, seraient la catégorie dominante tandis que les personnes blanches, les Nihils, seraient la catégorie dominée. Ce procédé permet de mettre à jour les différences qui existent en termes de pouvoir, de richesse, d’accès à l’éducation, à l’emploi… Les intolérances et les inégalités décrites, dans la trame du roman et à travers l’histoire romantique qui se crée entre les deux protagonistes Callum et Séphy, sont l’occasion d’une démonstration du racisme structurel qui existe dans nos sociétés.
D’autres romans s’ancrent plus dans la réalité pour nous parler du racisme concret que subissent les personnes noires. Black Saphir, de Marc Séassau, montre les insultes et le rejet que le père d’un ami fait subir à l’héroïne éponyme venue de Mayotte. De même, Erwan, jeune personnage métis du roman Uppercut d’Ahmed Kalouaz, se retrouve, dans un centre équestre où il doit faire un stage, au contact d’un patron caractérisé par un racisme ordinaire très ancré et d’autres personnages emplis de préjugés. Par ailleurs, Jodi Picoult s’attache, elle aussi, à décrire, dans Mille petits riens, ce racisme ordinaire qui perturbe significativement le quotidien des personnes racisées. En l’occurrence, cette réflexion est mise en perspective avec l’histoire de Ruth, seule sage-femme noire de son hôpital, et qui se retrouve accusée du meurtre d’un nouveau-né issu d’une famille de suprémacistes blancs. Cette trame est l’occasion de mettre à jour nombre de comportements courants vécus tout au long de sa vie par la protagoniste et qui, sous couvert de bienveillance ou de manière clairement malveillante, ne sont rien d’autre que des comportements discriminatoires à l’égard des personnes noires.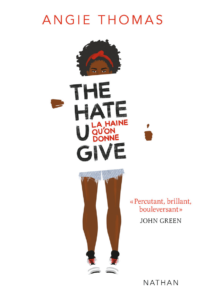
Enfin, la question des violences policières, particulièrement contre les personnes noires comme cela est fréquemment le cas aux États-Unis mais aussi en France, est traitée par Angie Thomas dans The hate U give Cette thématique est incarnée par le personnage de Khalil, tué par un policier blanc de trois balles dans le dos, sous les yeux de sa meilleure amie Starr. Ce roman prend naissance dans le mouvement Black Lives Matter, dénonçant les violences policières dont sont victimes les noirs, et, basé sur des faits réels, revêt un caractère presque documentaire.
Autre axe intéressant abordé par quelques auteurs : les problématiques liées aux conséquences de la colonisation et qui traduisent l’importance des origines dans la construction identitaire. Sur ce sujet, trois romans peuvent être cités. D’abord, Sarcelles Dakar d’Insa Sané, dans lequel Djiraël entreprend avec sa famille un voyage au Sénégal d’où sont originaires ses parents et au cours duquel il va en quelque sorte se réconcilier avec ses origines. De son côté, Les Déchaînés de Flo Jallier permet, grâce à quatre narratrices de la même lignée mais vivant à des époques différentes, de percevoir les conséquences de l’histoire de ses ancêtres. Ainsi, le lecteur peut notamment découvrir les cheminements d’Amelia, esclave en Martinique, puis de ses descendantes jusqu’à Marie-Jo, adolescente de nos jours qui va s’acharner à démêler son récit familial. Cette question de l’identité est également au centre du texte de Louis Atangana, Une étoile dans le cœur, dans lequel un jeune métis s’interroge sur son identité et sur ce que signifie être noir.
Pour finir, ce corpus peut être complété par une dernière réflexion. Représenter la vie contemporaine des personnes noires, ce n’est pas seulement évoquer les questions de racisme ou les combats civiques, c’est également représenter des modes de vie, des codes… Cette position reste taboue chez nous, où toute idée de communautarisme est généralement perçue comme négative, et ne sera pas exposée en littérature jeunesse. Néanmoins, aux États-Unis, une auteure comme Janet McDonald s’attache à présenter un tableau de la vie quotidienne des noirs américains. Même si leur parution n’est pas récente, la lecture de romans comme Brooklyn babies ou Des tifs et du taf demeure importante dans le but de s’imprégner des conditions de vie quotidienne d’une communauté régie par une organisation systémique de nos sociétés.
Ce corpus, principalement composé d’ouvrages destinés à un lectorat adolescent, tente de mettre en avant des séquences historiques marquantes pour les populations noires et d’interroger également les conséquences sur les descendants et descendantes. Toutefois, il semble important que les jeunes lecteurs ne s’en contentent pas et complètent leur connaissance de ces enjeux socio-historiques par la découverte d’auteurs majeurs, comme James Baldwin, Toni Morisson ou Maya Angelou.
