La question sexuelle n’est pas neuve dans la littérature jeunesse. Déjà Perrault mettait sur papier des contes destinés aux enfants et truffés de morales bien peu voilées sur la question. Et la métaphore de la bagatelle est en effet courante dans les contes, les comptines et les chansons. Au regard de ce bagage culturel historique, la littérature jeunesse d’aujourd’hui peut paraître à première vue fort chaste. La version actuellement en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, adoptée en 2011, comporte encore une dimension moralisatrice, mais elle ne cible plus aujourd’hui que les contenus spécifiquement pornographiques, ayant évacué la notion de « débauche ». C’est peut-être ce qui explique que le XXe siècle ait été une période de publications plutôt lisses sur ce sujet, du moins dans les ouvrages « grand public ». Le thème par excellence de la littérature jeunesse étant le récit initiatique, la question de la découverte du sexe ne pouvait être passée totalement sous silence, c’est pourquoi nous nous interrogerons dans ce Thèmalire sur la place qu’occupe la première expérience sexuelle dans les récits, lorsqu’elle n’est pas d’ailleurs au centre de l’histoire. S’agit-il d’utiliser les publications jeunesse pour sensibiliser les adolescents à un enjeu de santé et de société ? Est-ce un tabou qui se lève sur une étape de l’accomplissement vers l’âge adulte, et qui prend peu à peu sa place dans un domaine littéraire qui gagne en liberté ? Ou encore, admettons-nous aujourd’hui l’érotisme dans les genres destinés à la jeunesse ? Et pourquoi pas les trois ?
La première fois, un prétexte littéraire à la sensibilisation ?
La littérature de jeunesse conserve à travers le temps une entrée pédagogique, voire un peu moraliste, véhiculée par Perrault en son temps. Aussi, les premiers romans qu’on peut trouver, les plus référencés, les plus souvent mis en évidence dans nos CDI, sont souvent des récits de faits de société, qui traitent plus des conséquences possibles que du moment vécu.
 Ainsi, dans le roman Soixante-douze heures, de Marie-Sophie Vermot, la première fois de l’héroïne Irène n’existe qu’en flash-back. Son histoire, c’est celle qui a suivi cette première fois, le rapport sexuel constitue l’élément déclencheur, pas le récit. Et Irène nous raconte ainsi son accouchement sous X, à 17 ans. On retrouve le même thème dramatique dans le court roman de Jo Witek, Trop tôt : une belle et intense expérience amoureuse au bord d’une plage, racontée dans les premiers chapitres, est suivie d’une lourde décision à prendre : avorter ou pas ?
Ainsi, dans le roman Soixante-douze heures, de Marie-Sophie Vermot, la première fois de l’héroïne Irène n’existe qu’en flash-back. Son histoire, c’est celle qui a suivi cette première fois, le rapport sexuel constitue l’élément déclencheur, pas le récit. Et Irène nous raconte ainsi son accouchement sous X, à 17 ans. On retrouve le même thème dramatique dans le court roman de Jo Witek, Trop tôt : une belle et intense expérience amoureuse au bord d’une plage, racontée dans les premiers chapitres, est suivie d’une lourde décision à prendre : avorter ou pas ?
Si la première fois n’y est pas du tout tabou, ces deux romans ont comme point commun de ne pas la mettre au cœur du récit : elle est le point de départ d’un récit ultérieur, qui se centre sur les conséquences plus que sur le moment vécu. Cette première fois reste d’abord le déclencheur d’une situation dramatique : la grossesse, l’avortement, ou encore l’abandon.
Ces questions sont bien sûr importantes dans la construction d’un rapport responsable au sexe, et traitées avec bienveillance et absence de jugement dans les deux ouvrages cités, mais la question du passage à l’âge adulte est ici un prétexte à la sensibilisation, à de la prévention. C’est souvent la raison pour laquelle ces ouvrages sont mis en avant les premiers : ils racontent, très bien et avec un regard doux, des moments difficiles, des choix, une réalité dont on aimerait que tous nos jeunes prennent conscience. En contrepartie, on peut avoir la sensation en lisant Soixante-douze heures que la première fois ne vaut pas vraiment comme un acte qui serait déjà une expérience en soi. Comme si l’important n’arrivait qu’après…
Le roman de Jo Witek, Trop tôt, s’attarde un peu plus longtemps sur l’expérience de la première fois, sur l’acte lui-même et les heures qui le suivent. La jeune Pia, quinze ans, raconte sa rencontre avec Nathan, leur escapade de nuit sur la plage, le plaisir des baisers et des caresses : « C’est ainsi que je me souviens de cette première nuit d’amour et c’est pourquoi je ne la regretterai jamais ». Elle raconte aussi la gêne du petit matin, le retour au quotidien, l’envie de revoir le garçon, son refus à lui et l’humiliation de ce rejet. Puis, très vite, l’histoire se centre sur cet « après », sur ces conséquences dramatiques qui suivent l’abandon au plaisir.
De l’ellipse au détour d’une page…
On l’a dit, la première fois, quelle que soit l’expérience dont il s’agit, est le principe même du récit initiatique. De nombreux romans réalistes, racontant des parcours d’adolescents, voient leur personnage principal se confronter à cette question. Sans être au cœur de l’histoire, il s’agit d’une étape indéniable. Si elle est souvent traitée par l’ellipse, l’évocation, le souvenir, la métaphore, elle existe cependant, ainsi que les questionnements qui s’y rattachent.
Dans sa saga Comment bien rater ses vacances, Anne Percin raconte le quotidien de Maxime, un adolescent de 17 ans, et son évolution : le jeune homme, accro aux réseaux sociaux, à ses amis et à la musique, va devoir s’occuper de sa grand-mère hospitalisée et survivre seul ; puis, il découvre l’amour et le travail en équipe avec son groupe de rock… Le deuxième volet de la saga, Comment bien gérer sa love story, met l’accent sur sa relation naissante avec Natacha. Lorsque Maxime a l’occasion de passer pour la première fois la nuit chez sa petite amie, il raconte ses premiers moments de sensualité et de désir. Le roman est raconté à la première personne, et Maxime entretient pendant tout le récit une forte connivence avec son lecteur, agrémentée de clins d’œil, de notes de bas de page truffées de private jokes et de souvenirs communs établis au fur et à mesure de la lecture. Sa première fois est donc traitée par une belle ellipse, qui lui permet de mettre en avant sa pudeur et l’intimité du moment vécu avec une bonne dose d’humour et d’autodérision.
Le roman de Bertrand Jullien-Nogarède aborde cette étape de façon beaucoup plus sérieuse dans La première fois que j’ai été deux. Ce roman sentimental raconte la rencontre de Karen, une jeune adolescente désabusée des relations amoureuses, avec Tom Darcy, un jeune anglais qui lui fait découvrir l’amour. Ce roman très introspectif nous emmène dans leur voyage à Londres dans la famille de Tom, et s’attarde sur leurs échanges et discussions autour de l’amour et de leur avenir. Loin d’une relation charnelle et sensuelle, les deux héros sont plutôt portés sur le sentiment et l’intellect. Pour Karen, la première fois se passera dans un hôtel, “comme dans un rêve”… et il n’en sera très vite plus question !
Parmi les récits qui mentionnent cette étape de la première fois, certains sont notables pour avoir raconté une première fois… ratée. C’est le cas dans Geneviève, le quatrième tome de la saga Quatre sœurs de Malika Ferdjoukh. Dans cette fresque familiale dépeignant les déboires de cinq sœurs orphelines, chaque tome s’attache plus particulièrement à l’une des sœurs, héroïne éponyme du volume. Geneviève est le quatrième tome : la jeune fille est la deuxième de la fratrie, âgée de 16 ans, réservée et dévouée à sa famille. Donc, lorsqu’elle rencontre Vigo, le bad boy par excellence, son côté raisonnable est un peu bousculé. Après une soirée en amoureux catastrophique, Vigo toque à sa fenêtre et la rejoint dans sa chambre. Rien ne se passe comme dans son imagination : elle porte son tee-shirt le plus vieux et le plus moche, le chat est caché sous la couverture, le lit est dans une commode ancienne étroite et grinçante, le préservatif tombe derrière le matelas, une chauve-souris rentre dans la chambre, et ils sont finalement interrompus par Charlie, l’aînée des sœurs, avant même d’avoir commencé. Malika Ferdjoukh réussit pourtant à montrer dans leur maladresse la sensualité du moment, le désir qu’ils ont l’un pour l’autre. Partie remise, mais un premier contact avec le sexe qui leur donne l’envie d’y revenir.
Notre feu, publié en 2021 par Alexandre Chardin, commence également sur une première fois ratée, mais pour d’autres raisons. Là où celle de Geneviève échoue en raison du contexte et de la maladresse, c’est le stress de la performance qui gâche le premier rapport de Colin. Le roman débute sur l’angoisse numéro un des garçons confrontés à leurs débuts sexuels : l’éjaculation précoce, l’incapacité à aller au bout de l’acte, l’humiliation de ne pas avoir réussi et le rejet de la fille. Colin, sportif de haut niveau, part le lendemain de cette expérience ratée loin de sa petite amie, en vacances avec sa famille. Ces vacances auront leur lot de premières fois, et parmi elles la rencontre avec une jeune fille qui ne lui plaît pas plus que cela, mais qui finira par le séduire grâce à d’autres atouts. D’un roman initiatique au synopsis somme toute assez banal, Alexandre Chardin réalise finalement une œuvre jeunesse qui fait l’éloge de la séduction. Comment Colin se laisse-t-il charmer par Ada, au point d’en tomber follement amoureux ? Comment arrive-t-il avec elle à laisser le désir opérer sans faire de l’acte d’amour une épreuve à réussir ? Ce n’est pas uniquement la première fois de Colin qui nous est racontée, c’est sa première fois partagée avec l’autre. Notre feu s’inscrit dans un mouvement plus moderne de la littérature jeunesse, où le sexe passe d’une étape du développement de l’adolescent à un thème central de la littérature.
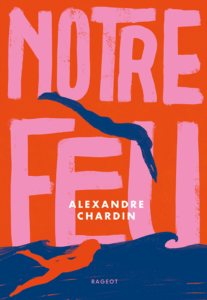
… À un thème éditorial
S’agit-il d’une libération des mœurs concernant la jeunesse ? Est-ce une réaction à l’accès de plus en plus facile à la pornographie ? À la présence de moins en moins censurée des scènes de sexe dans les films et séries pour ados ? Au succès des fanfictions et des autopublications de romances érotiques comme 50 nuances de Grey ? Toujours est-il qu’aujourd’hui, la littérature érotique pour les jeunes a fait son entrée dans les librairies, et qu’une réelle demande éditoriale, concernant les œuvres jeunesse qui s’emparent d’érotisme, existe.
Au-delà des textes aussi controversés que le roman de E. L. James, les auteurs se sont emparés du sujet avec des ouvrages qui ont toute leur place dans un CDI. Au contraire, ils se sont attachés à prouver qu’on peut parler d’érotisme aux adolescents sans faire l’apologie de la soumission ou du masochisme.
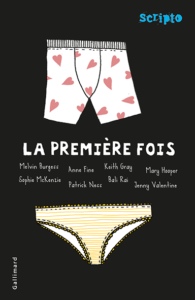 L’éditeur anglo-saxon Andersen Press a par exemple commandé en 2010 à l’auteur Keith Gray un recueil de nouvelles, paru sous le titre original Losing it, et traduit en français sous le titre La première fois. Le titre original est explicite : toutes les nouvelles sont centrées autour de la virginité, de la manière de la perdre et des représentations qui y sont liées : pourquoi la perdre ? Quelle sera mon image, ma réputation auprès des autres si je l’ai encore ou au contraire si je ne l’ai plus ? Est abordée également la question épineuse de la religion, de la tradition, de l’époque, et donc du tabou dans le cercle familial ou amical. Séducteur ou traînée ? Libre d’être attiré.e par le même sexe ou pas ? Le premier rapport étant au centre de chaque récit, chaque auteur aborde un non-dit, une peur, ou une représentation à déconstruire.
L’éditeur anglo-saxon Andersen Press a par exemple commandé en 2010 à l’auteur Keith Gray un recueil de nouvelles, paru sous le titre original Losing it, et traduit en français sous le titre La première fois. Le titre original est explicite : toutes les nouvelles sont centrées autour de la virginité, de la manière de la perdre et des représentations qui y sont liées : pourquoi la perdre ? Quelle sera mon image, ma réputation auprès des autres si je l’ai encore ou au contraire si je ne l’ai plus ? Est abordée également la question épineuse de la religion, de la tradition, de l’époque, et donc du tabou dans le cercle familial ou amical. Séducteur ou traînée ? Libre d’être attiré.e par le même sexe ou pas ? Le premier rapport étant au centre de chaque récit, chaque auteur aborde un non-dit, une peur, ou une représentation à déconstruire.
Une anthologie sur le même thème, française cette fois, a été publiée par les éditions Eyrolles. 16 nuances de premières fois : le titre souhaite sans aucun doute prendre le contre-pied de 50 nuances de Grey. La première fois est ici abordée dans un sens un peu élargi : première fois que ça a été bien, première fois avec un autre garçon, est-ce qu’entre filles ça compte, même sans pénétration ? Ce recueil coordonné par Manu Causse et Séverine Vidal apporte cependant une variation inattendue sur le thème, avec des récits situés dans un univers fantastique ou d’anticipation qui décalent le propos.
On retrouve toutes les angoisses de l’adolescent liées à sa première expérience sexuelle dans le roman américain de Cameron Lund, La toute première fois. Keely, seule vierge de son petit groupe d’amies, rencontre un garçon qui lui plait mais a terriblement peur de paraître inexpérimentée. Elle choisit de désacraliser ce moment en demandant à son meilleur ami et tombeur de réputation d’être son premier et de lui apprendre. Elle se questionne sur la différence entre désir et sentiment, l’importance de la confiance dans le partenaire, la complexité des relations amoureuses, amicales et sexuelles.
On voit qu’un tournant a été franchi dans la définition des publications destinées à la jeunesse en observant l’augmentation des ouvrages récents qui font la part belle au thème du sexe. L’éditeur Thierry Magnier a créé en 2019 une collection entièrement consacrée à la question sexuelle chez les adolescents, intitulée L’ardeur. Les trois mots qui accompagnent le nom de la collection montrent le choix éditorial : « lire, oser, fantasmer ». Il ne s’agit pas uniquement de traiter d’un fait de société, d’une étape du développement, mais aussi d’aborder le sexe par l’imaginaire, l’érotisme et la découverte. Parmi les dix titres de la collection, nous en avons retenu trois dans notre bibliographie. Dans Touche-moi, de Susie Morgenstern, Rose raconte sa vie d’adolescente albinos, qui rêve des garçons alors qu’ils n’osent pas l’approcher. Elle confronte ses fantasmes à la réalité, se demandant à partir de quand le sexe devient une obsession, se questionne sur l’image du sexe qu’elle se construit avec la pornographie. La question du handicap est également présente dans le roman de Camille Emmanuelle, Le goût du baiser. Aurore est une jeune fille qui a perdu le goût et l’odorat dans un accident. Ce récit aborde de manière surprenante le complexe, avec un handicap qui ne se voit pas, mais qui crée une réelle angoisse chez l’adolescente : est-ce que je sens mauvais ? Comment m’en rendre compte ? Elle fait apparaître une autre dimension de la sensualité en mettant à l’honneur l’importance des cinq sens dans la relation intime. Enfin, toujours dans cette collection, Les premiers plans de Rémi Giordano pose la question du coming out, de la découverte du sexe pour un jeune homosexuel qui se cherche et se pose des questions bien spécifiques : serai-je actif ou passif ? Est-ce important ? Est-ce qu’on peut changer après ? Une collection à découvrir et à intégrer à vos rayonnages de lycée, car les auteurs n’y mâchent pas leurs mots.
Nous pouvons terminer ce panorama avec un ouvrage qui fait un peu figure d’OVNI, D’or et d’Oreillers de Flore Vesco. Réécriture de contes de fée, ce roman reprend leurs versions non édulcorées pour les enfants et multiplie les références à ces différentes histoires, de Barbe Bleue à Cendrillon en passant par Le Monde de Narnia. Ainsi, lorsque notre princesse au petit pois passe quelques nuits chez son prétendant, elle découvre son corps, la masturbation, le plaisir de voir l’autre et de se laisser voir, bref, elle découvre le désir, le corps et la séduction.
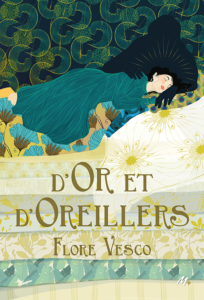
Le sexe et sa découverte ont bel et bien toute leur place dans la littérature jeunesse aujourd’hui, et les choix de lectures et de films des adolescents témoignent d’une vraie demande sur ce thème. Il est difficile de faire l’impasse sur cette étape signifiante du développement de l’adolescent dans des récits souvent initiatiques. Le roman est également un outil majeur de sensibilisation, d’information, notamment émotionnelle : il permet de découvrir comment d’autres ont vécu ce moment, y compris dans l’imaginaire et d’avoir un espace de questionnement et de tâtonnement. Mais c’est aussi un vrai sujet littéraire complexe qui comporte ses propres codes, ceux de l’érotisme, du fantasme, et qui n’est plus réservé aux adultes.
