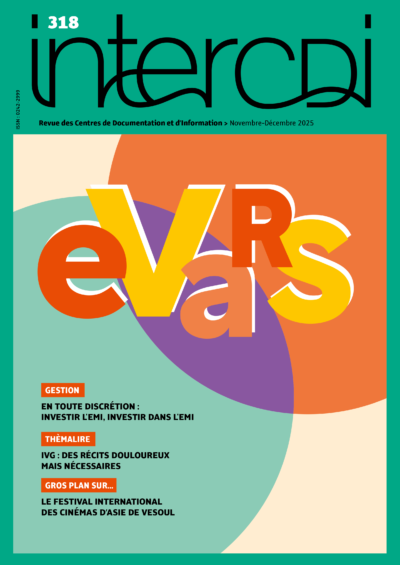122 600 victimes de violences sexuelles enregistrées, dont 85 % de femmes, selon le ministère de l’Intérieur en 20241 ; 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes victimes dans leur enfance, selon le rapport de la CIIVISE en 20232 sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Si, à ces constats chiffrés, on ajoute la lecture du rapport 2025 sur l’état du sexisme en France publié par le Haut Conseil à l’Égalité3, on comprend qu’il est grand temps de rendre réellement effective l’éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité. Les nombreuses polémiques ou recours, qui viennent perturber cette mise en place, n’ont pas lieu d’être au regard de la gravité des constats : violences sexuelles systémiques, inégalités filles/garçons persistantes, discriminations de genre, absence d’éducation au consentement, montée du masculinisme, notamment chez les jeunes garçons. Comment faire pour permettre une réelle égalité fille/garçon ainsi que le développement de relations harmonieuses et respectueuses de l’orientation sexuelle de chacun, basés sur une connaissance solide du corps et de l’esprit ?
Qu’en est-il de l’Éducation nationale, face à l’urgence de la situation ? Depuis 2001, une éducation à la sexualité est obligatoire, à raison de trois séances par année scolaire et par niveau. Un programme officiel a été formalisé en 2025 avec, sur Eduscol, des ressources pour mener à bien des séances ou projets sur l’EVARS.
Dans les faits, c’est beaucoup moins évident, étant donné que cet enseignement repose sur le volontariat, tant pour la formation que pour la mise en œuvre, et qu’aucun personnel n’est désigné pour enseigner cette matière, en dehors des infirmières dont la présence est vivement recommandée.
Dans les établissements scolaires, sous l’impulsion des chefs d’établissements, des groupes de personnels éducatifs (enseignants, CPE, infirmière…) se forment, des stages ont lieu, des associations interviennent, des actions sont mises en place : emprunt d’expositions, visionnage de films puis débat, co-intervention, invitation d’intervenants, notamment. Une démarche collégiale et concertée est, en effet, indispensable sur ces sujets, car il va sans dire qu’il n’est pas simple de proposer des ressources et des séances adaptées qui respectent la sensibilité de chacun. Les professeurs documentalistes peuvent, par exemple, s’inscrire pleinement dans cet enseignement en proposant des bibliographies/sitographies, en facilitant les relations avec des partenaires extérieurs collectivement et soigneusement choisis ou encore en coréalisant des séances pédagogiques.
Ainsi, Aline Royer, professeure documentaliste, propose une Ouverture culturelle comprenant l’interview d’une autrice, Sophie Adriansen, autour de son ouvrage Le ciel de Joy dans lequel elle aborde le thème de l’IVG d’une jeune fille mineure, confrontée à la difficulté de trouver la bonne personne pour l’accompagner dans cet acte choisi. Pour élargir la question à l’ensemble des thématiques relatives à l’EVARS, une sélection de ressources accompagne cet entretien. Parmi les propositions de pistes pédagogiques, en EMI, un travail de réflexion sur les représentations des hommes et des femmes dans les médias. Afin d’approfondir le sujet de l’avortement, un Thèmalire de la même autrice permet de conseiller les collègues dans leurs choix de lectures à destination des élèves.
Enfin, n’oubliez pas de lire l’excellent roman de Nathacha Appanah, La nuit au cœur4, sélectionné, entre autres, pour le Goncourt et le Renaudot des lycéens, un récit dans lequel elle revient sur le féminicide d’une de ses cousines, celui de Chahinez Daoud pour lequel son mari a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2025. L’autrice évoque également, pour la première fois, l’emprise et la violence exercées sur elle par un écrivain plus âgé, alors qu’elle était toute jeune autrice.