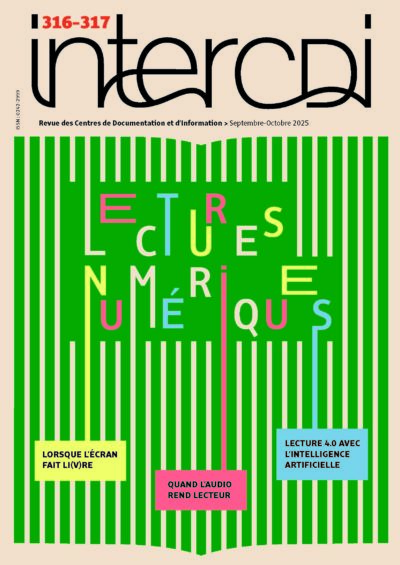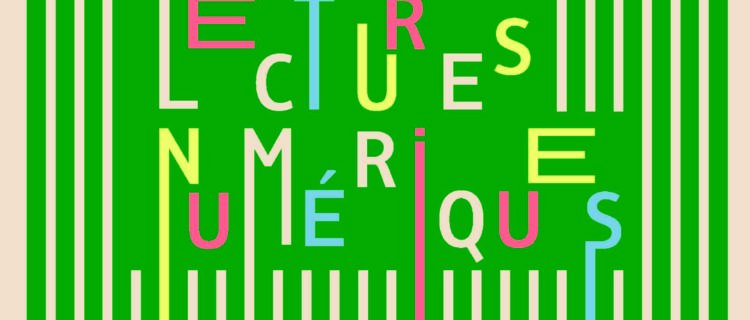En quelques années, le numérique a profondément transformé notre rapport au livre et à la lecture. Tablettes, smartphones, liseuses, ordinateurs : les écrans sont partout et l’écrit n’a jamais été aussi accessible. Du roman classique au dernier essai, du webtoon aux fanfictions, des articles scientifiques aux livres audio, les formats, supports et genres se sont multipliés, fragmentés, recomposés. Et avec eux, nos habitudes de lecture, nos rythmes, nos postures, nos environnements. Ce dossier intitulé Lectures numériques (au pluriel) assume pleinement cette diversité.
Car s’il y a un point commun entre toutes les contributions ici rassemblées, c’est bien la volonté de ne pas réduire la lecture numérique à une simple transposition du papier vers l’écran. Lire sur une tablette n’est pas seulement « lire autrement » : c’est lire dans un autre écosystème technique, social, cognitif. C’est accéder à des contenus que le papier ne propose pas toujours et parfois, redécouvrir le plaisir de lire autrement…
Le numérique sauvera-t-il la lecture chez les jeunes ?
C’est la question ouverte par Anne Jonchery et Sylvie Octobre en introduction. Elles nous invitent à sortir des constats alarmistes pour mieux comprendre comment les jeunes lisent aujourd’hui, à la lumière de leurs pratiques numériques. Car non, ils n’ont pas cessé de lire ; ils lisent différemment, ailleurs, autrement. Et cette lecture, souvent fragmentaire, parfois multimodale, mérite d’être reconnue et analysée.
Quand l’écran fait li(v)re
Manon Ortin explore cette mutation dans un article riche d’exemples concrets. Entre eBooks, stories, webtoons ou romans interactifs, les formats se diversifient, avec des impacts profonds sur les modes de consommation, la posture cognitive, la temporalité de la lecture. Ce n’est plus seulement l’œuvre qui change : c’est le lecteur lui-même, sa manière d’entrer dans le texte, de le parcourir, de l’interpréter. Il n’y a pas une lecture numérique, mais bien des lectures numériques, aux seuils poreux, parfois hybrides.
Le numérique est aussi un levier d’inclusion et d’accompagnement. Yade George et Valérie Poties en font la démonstration à travers une expérience menée en collège avec des liseuses pour aider à l’amélioration des compétences en langue étrangère. La portabilité, les outils d’annotation, la possibilité d’adapter la police ou la mise en page font de la lecture numérique un appui pédagogique précieux.
Quand l’audio rend lecteur
Dans la même logique d’accessibilité, les articles de Claire Bauda et Catherine Arnaud mettent en lumière le potentiel du livre audio. Loin d’être une « sous-lecture », l’audio engage l’imaginaire, développe des compétences de compréhension et d’écoute, et peut rendre la lecture possible à celles et ceux qui en sont éloignés, pour des raisons cognitives, culturelles ou scolaires. Intégrer le livre audio dans les CDI, c’est offrir une autre porte d’entrée dans l’univers du texte.
Lecture 4.0 avec l’intelligence artificielle
Enfin, ce dossier se clôt sur deux contributions autour d’un sujet émergent : la lecture à l’ère de l’intelligence artificielle. L’équipe de l’Université de Lille (Falc, Grodzki, Begaud) propose une enquête sociologique sur les usages de l’IA par les lecteurs universitaires. Quelles aides au repérage d’informations ? Quels nouveaux outils de recommandation ? Quels risques d’automatisation de la pensée critique ?
Cécile Heckel, quant à elle, interroge les potentialités pédagogiques de l’IA pour renouveler les pratiques de lecture et d’écriture dans les CDI. Dans un contexte de mutations rapides, l’enjeu est moins de suivre une mode que de penser avec exigence les médiations numériques possibles, dans un cadre éthique et éducatif.
Pluralité, complexité… et responsabilité
Ce dossier n’offre pas une réponse tranchée, ni un plaidoyer inconditionnel pour la lecture numérique. Il donne à voir une réalité composite, parfois contrastée, toujours en mouvement. Il invite à sortir des oppositions stériles entre papier, écran et audio, pour mieux penser les continuités et les ruptures. Car l’important n’est pas tant le support que le lecteur. Et si la lecture numérique peut permettre de renouer avec les mots, alors elle a toute sa place dans le paysage éducatif et culturel.
Enfin, cette transition numérique a un coût : lire sur écran, c’est aussi consommer de l’énergie, des ressources matérielles, des serveurs, des terminaux, souvent conçus dans des conditions sociales et écologiques discutables. Face à cela, la sobriété numérique, la mutualisation des ressources, la formation à des usages conscients doivent être au cœur de nos pratiques professionnelles afin que lire demain respecte la planète.
Lectures numériques, lectures plurielles : ce dossier vous invite à explorer ces nouveaux territoires avec curiosité, prudence, et enthousiasme critique.